Article 30-1 (article R.4127-30-1 du code de la santé publique)
Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ses titres.
Covid-19 : initiatives dans les territoires

Tous les échelons de l’Ordre des médecins sont engagés dans cette campagne. Les conseils départementaux et régionaux ont ainsi mis en œuvre ou ont participé à des initiatives visant à organiser le déploiement de la campagne vaccinale dans les territoires, partout en France.
En voici quelques exemples :
Centres de vaccination
- Les conseils départementaux de Haute-Garonne et de Haute-Savoie ont mis en place dans leurs locaux des centres de vaccinations pour les professionnels de santé. Le CDOM a également mené cette action de vaccination en janvier et l'a renouvelée en mars.
- Dès le 30 décembre 2020, le CDOM 31 a obtenu que 10 centres de vaccinations soient mis à disposition des professionnels de santé (2 étaient prévus au départ) sur le territoire de la Haute-Garonne ; leur ouverture a été effective le 6 janvier 2021. Il a également permis que les secrétaires médicales puissent être vaccinées au même titre que les autres professionnels de santé.
 |
Centre de vaccination en Haute-Garonne |
- La Haute-Vienne a participé à la mise en place d’un centre de vaccination dans les locaux de la polyclinique de Limoges. La collaboration avec l’Ordre infirmier a permis d’assurer des vacations permettant ainsi la formation de binômes de vaccinateurs.
- Le conseil départemental de l’Aveyron a également participé à la création des centres de vaccination de son département, en étroite collaboration avec l’Ordre des infirmiers et la CPTS.
- Le Conseil départemental de la Marne a participé à la mise en place du 1er centre de vaccination pour les professionnels de santé dès le 09 janvier 2021. Cette première expérience a permis d'initier la mise en place de 9 centres de vaccinations sur le département afin de vacciner les professionnels de santé de plus de 50 ans et les patients de plus de 75 ans.
Sollicitation des médecins
De nombreux conseils ont sollicité les médecins, actifs ou retraités, afin qu’ils participent à la campagne de vaccination, en prêtant main forte dans des centres ou dans des EHPAD notamment. C’est notamment le cas de l’Aveyron, de la Haute-Corse, de la Creuse, du Jura, de la Haute-Loire, du Vaucluse et de la Haute-Vienne.Autres initiatives
- Organisation coordonnée Ville /Hôpital de la vaccination contre la COVID19 par les médecins généralistes sur les territoires du Lunévillois et du Sel et Vermois en complément des centres de vaccination : Cette organisation pluri-professionnelle est soutenue par les URPSs Médecins et Pharmaciens du Grand-Est, le Conseil régional de l'Ordre des médecins, l'ARS Grand-Est et la Préfecture de Meurthe-et-Moselle.
- A la Réunion le variant Sud-Africain est largement prédominant, pour y faire face la vaccination avec le vaccin Pfizer a été étendue progressivement en ville depuis le 6 avril 2021 après une période de test, c'est une première en France. Le conseil régional de La Réunion-Mayotte de l'Ordre des médecins, le CDOM de la Réunion ont participé activement à la mise en oeuvre de cette initiative en collaboration avec les représentants des professionnels libéraux et l'ARS.
- Déploiement d'une unité mobile de vaccination dans le Cantal :
Cette équipe mobile de vaccination est portée par l’Ordre des médecins du Cantal, avec l’appui des professionnels de santé libéraux du territoire et la contribution du Conseil départemental, qui met à disposition des véhicules. L’ARS et la Préfecture pilotent la mise en place de ce dispositif.
- Dans l’Ariège un « comité stratégique vaccination » a été installé sous l’égide de la Préfète et de l’ARS, ainsi qu’une « cellule opérationnelle vaccination » à laquelle participe le conseil départemental de l’Ordre des médecins.
- Le Conseil régional des Hauts-de-France de l’Ordre des médecins et le CDOM 59 ont participé à la rédaction d’une convention ayant pour objet de définir le cadre de la collaboration entre le médecin libéral et le CHU de Lille au sein du centre de vaccination implanté au CHU de Lille.
- Plusieurs conseils départementaux envoient régulièrement aux médecins des informations mises à jour. Parmi eux, la Haute-Corse, la Loire, la Haute-Vienne, ou encore le Vaucluse. Nombre d’entre eux ont également communiqué dans la presse et sur les réseaux sociaux lors de la vaccination des membres des conseils départementaux, par devoir d’exemplarité, afin d’inciter leurs patients à en faire de même (Ordres de la Loire, de la Haute-Loire, du Maine-et-Loire, du Puy-de-Dôme, du Vaucluse…).
Protocole sur la prise en charge des violences conjugales

Le 10 février à Marseille a été signé un protocole sur la prise en charge des violences conjugales, définissant les relations entre le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre des médecins et les parquets de Marseille, d’Aix-en-Provence et de Tarascon.
En permettant une relation simplifiée entre les médecins du département et la Justice, ce protocole apportera un soutien aux médecins dans l’accompagnement et la prise en charge des victimes de violences conjugales.
Il a été signé par Madame le Docteur Marie-Dominique Métras, Présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre des médecins, Madame Dominique Laurens, Procureure de la République près le Tribunal Judicaire de Marseille, Monsieur Achille Kiriakides, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence et Monsieur Laurent Gumbau, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Tarascon.
Ce protocole est le premier en France. A terme, des protocoles semblables seront signés dans l’ensemble des départements. Cette démarche est le prolongement du soutien du Conseil national de l’Ordre des médecins au fait pour les médecins de pouvoir effectuer un signalement à la Justice dans les cas de violences conjugales, sans accord de la victime. Cette évolution, inscrite dans la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, permet à tout médecin estimant en conscience que sa patiente est en danger vital immédiat et qu’elle se trouve sous l’emprise de l’auteur des violences, de réaliser un signalement au procureur de la République en informant la victime.
Afin d’accompagner les médecins dans la mise en œuvre de cette nouvelle disposition, le Conseil national de l’Ordre des médecins, le ministère de la Justice et la Haute Autorité de Santé ont réalisé en octobre 2020 un
En parallèle de ce travail sur les violences conjugales, le Conseil national a été à l’initiative de la création, en avril 2020, du Comité national des violences intrafamiliales. Composé de 70 experts inter-institutionnels et pluridisciplinaires (professionnels de santé, du droit et de la justice, représentants des forces de l’Ordre, d’associations, et de grandes institutions…), le CNVIF est un comité indépendant consultatif ayant des actions d’avis et de recommandations aux pouvoirs publics et grandes instances. Présidé par Marie-Pierre Glaviano-Ceccaldi, vice-présidente du Conseil national de l’Ordre des médecins, le CNVIF est un prolongement de l’engagement de longue date de l’Ordre des médecins contre les violences conjugales et intra-familiales.
Brève Covid 08


Un médecin peut-il refuser d’établir un certificat médical initial ?
Il appartient au premier médecin constatant les lésions d’établir un certificat médical initial d’accident du travail, dès lors que le patient signale qu’il s’agit d’un accident du travail.Il est indifférent que le salarié soit en possession ou non d’une déclaration d’accident du travail rédigée par son employeur.
Aux termes de l’article 50 du code de déontologie médicale, « le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit ».
Un médecin du travail doit-il déclarer un accident du travail ?
Il ne ressort pas des missions du médecin du travail de déclarer les accidents du travail.Il revient à l’employeur d’effectuer cette déclaration auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Que doit constater le médecin au sein du certificat médical initial ?
Les écrits des médecins engagent leur responsabilité. Le médecin ne peut que certifier les faits médicaux personnellement constatés à travers un examen médical.Le certificat ne doit en aucun cas reprendre les circonstances de l’accident relatées par le patient. Il n’appartient pas au médecin de faire le lien entre l’accident et le travail.
Le médecin doit indiquer, sur le certificat médical, si le salarié lui a présenté ou non la feuille d’accident du travail (item correspondant sur le formulaire Cerfa).
Si la feuille est présentée, la victime bénéficie du tiers payant intégral en application de l’article L. 432-3 du code de la sécurité sociale.
Qui établit le lien de causalité ?
Aux termes de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, il appartient à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de statuer sur le caractère professionnel de l’accident dans le respect des délais réglementaires (30 jours ou 90 jours en cas d’investigations complémentaires).À défaut de réponse dans ces délais, un accord implicite est acquis.
À quelle date doit être établi un certificat médical initial ?
Le certificat médical initial ne peut être daté que du jour de la consultation. Il ne peut en aucun cas être antidaté.Le médecin peut cependant rapporter dans le formulaire Cerfa les constatations faites lors d’une consultation antérieure où le patient n’aurait pas évoqué un accident de travail, en précisant « j’ai constaté lors de mon examen du… ».
Mésusage de la télémédecine
Vaccination des soignants de première ligne

Devant la hausse des contaminations de soignants de première ligne, l’Ordre des médecins appelle à accélérer leur vaccination pour leur permettre de continuer à soigner et pour protéger leurs patients.
La recrudescence des cas de Covid-19 chez les médecins et les autres personnels soignants de première ligne est signalée. Cela fragilise, voire neutralise, les capacités de prise en charge des patients alors qu’il apparaît clairement que la tension pesant sur notre système de santé sera très forte dans les prochaines semaines, malgré les efforts que nous menons tous pour nous protéger et protéger nos proches. Il est essentiel que les capacités de soin puissent continuer à être pleinement mobilisées, et que la contamination de soignants de première ligne ne compromette pas la sécurité des patients.
Dans ce contexte, et alors que notre stratégie vaccinale doit pouvoir évoluer pour tenir compte des évolutions constatées sur le terrain, l’Ordre des médecins appelle à ce que la vaccination de tous les médecins et des personnels soignants agissant en première ligne soit rapidement mise en œuvre, sans critère d’âge ni de comorbidités. L’Ordre rappelle par ailleurs qu’il est impératif que la seconde injection vaccinale soit garantie sur tout le territoire dans les délais validés, comme vient de le rappeler le Ministre des Solidarités et de la Santé.
Cette protection est primordiale pour éviter que la hausse des contaminations de soignants de première ligne ne vienne obérer les capacités de notre système de santé, mais aussi pour atténuer les foyers de contamination au contact des patients, notamment les plus fragiles.
Protéger les médecins et les professionnels de santé qui interviennent chaque jour auprès de patients malades de la Covid-19, c’est préserver leur capacité de soigner et de protéger leurs patients et ainsi permettre à notre système de santé de rester debout face à une pandémie malheureusement toujours très sévère.
Article 19-2 (article R. 4127-19-2 du code de la santé publique)
Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de médecin en France a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
Cette situation vise uniquement les médecins titulaires de titres obtenus au sein de l’Espace économique européen, dont la spécialité n’est pas reconnue en France.
L'objectif de cette disposition d’accès partiel, introduite en France par une transposition de la directive européenne relative à la reconnaissance des qualifications, est de permettre à un médecin d'exercer son activité en France, sans avoir l'obligation de suivre une nouvelle formation complète dans la spécialité existante en France.
Cela suppose que le médecin soit pleinement qualifié pour exercer, dans l'État membre d'origine, l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité en France.
Ceci suppose aussi que l'activité professionnelle considérée puisse objectivement être séparée des autres activités relevant de la spécialité en France.
Les médecins venus d’autres Etats membres, qui ont été autorisés par arrêté ministériel à exercer partiellement, doivent informer, par tout support, les patients, leurs confrères et plus généralement l’ensemble des personnes en lien avec leur exercice des actes qu’ils sont habilités à pratiquer dans le champ de la spécialité au titre de laquelle ils sont inscrits.
Les patients doivent être préalablement informés par tout support.
Cette disposition s’applique également à la libre prestation de services.
Article 19-1 (Art. R. 4127-19-1 du code de la santé publique)
I. Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
Pour ce qui est des commentaires de cet article, il y a lieu de se rapporter :
I. Aux « Recommandations du conseil national de l'ordre des médecins sur les informations susceptibles d’être portées à la connaissance du public par les médecins » pour ce qui est de leurs compétences et pratiques professionnelles. (voir ci-dessous)
II. Aux observations formulées aux du code de la santé publique qui valent aussi pour la communication d’informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à la discipline du médecin ou à des enjeux de santé publique.
Sont visées non seulement les participations du médecin à des actions de communication formalisées, mais également toute prise de position publique de sa part, qu’il en prenne l’initiative ou qu’elle soit sollicitée.
____________________________
Recommandations du Conseil national de l'ordre des médecins sur les informations susceptibles d’être portées à la connaissance du public par les médecins
L'article R. 4127-19-1 du code de la santé publique confie au Conseil national la mission d'émettre des « recommandations » dont le médecin doit tenir compte lorsqu’il communique au public des informations « relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice ».
Les présentes recommandations portent sur les trois domaines d'informations envisagées par les dispositions précitées : les compétences et pratiques professionnelles du médecin, son parcours professionnel, l’organisation de son activité et ses conditions d'exercice.
Les recommandations n’ont pas pour effet ou pour objet de créer pour les médecins des droits ou obligations supplémentaires ou distinctes par rapport aux droits et obligations définis en la matière par le code de déontologie. Elles sont destinées à les expliciter et à aider les médecins qui souhaitent diffuser des informations à le faire d’une façon qui soit pleinement conforme aux principes posés par le code de déontologie et qui réponde aux besoins et attentes des patients. En cas de poursuites à l’encontre d’un médecin, qu’elles soient disciplinaires, civiles ou pénales, le juge pourra tenir compte de ces recommandations pour apprécier le contenu et la portée de la règle de droit dont la méconnaissance est invoquée et pour apprécier la réalité du manquement reproché au médecin.
Ces recommandations couvrent, dans les principes qu’elles énoncent, tous types de supports utilisés par les médecins, à l’exception des informations susceptibles d’apparaître sur certains supports, comme les ordonnances et les plaques professionnelles, qui font l’objet d’une règlementation spécifique dans le code de déontologie aux articles et du code de la santé publique, dûment explicitée dans les Commentaires du code de déontologie. Elles concernent plus particulièrement le recours par les médecins à des sites internet.
Ces recommandations portent sur ce qui concerne directement les médecins dans leurs compétences ou leurs pratiques personnelles. Pour ce qui est des informations à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, il y a lieu de se référer aux Commentaires de l’article du code.
Il doit être précisé enfin que ces recommandations, qui portent sur les informations que les médecins peuvent ou non diffuser à l’intention du public en général, sont à bien distinguer de tout ce qui concerne la relation du médecin avec son patient. Les règles applicables en ce cas, posées par les articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique, sont, en effet, d’une tout autre nature et il ne doit y avoir aucune confusion entre ces deux situations.
I- Informations quant à la formation et aux pratiques professionnelles du médecin
1. Pour ce qui est de la formation professionnelle
Lorsque le médecin veut faire état de sa formation professionnelle, il lui est recommandé, pour ce qui est de sa formation professionnelle, de mentionner :
-
le diplôme de Docteur en médecine et le diplôme de spécialiste obtenus en indiquant les dates, lieu et établissement universitaire de délivrance de ces diplômes, sous réserve des dispositions de l’article
;
Si le médecin est titulaire de deux spécialités, il indique en premier la spécialité d’inscription. - sa formation spécialisée transversale (FST), option, diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I (DESC I), validation des acquis et de l’expérience (VAE), capacité.
- les formations complémentaires reconnues, suivies et validées par son Conseil National Professionnel (CNP) définies dans le parcours de développement professionnel continu (DPC) au cours des 6 dernières années dans le cadre de la certification périodique.
- les accréditations éventuellement délivrées par les autorités publiques durant leur période de validité.
Les diplômes non reconnus dans le cadre de l’exercice de la profession de médecin en France et les titres non autorisés par le conseil national ne doivent pas être mentionnés.
2. Pour ce qui est des pratiques professionnelles
S’agissant des pratiques professionnelles, le Conseil national considère que le critère premier est l’utilité de l’information pour le patient.
La mention de pratiques professionnelles diagnostiques et thérapeutiques non éprouvées est interdite.
Il est recommandé au médecin qui veut faire état de ses pratiques professionnelles, de mentionner :
-
les actes et soins habituellement pratiqués, leur nature, leur descriptif.
Par exemple, un médecin généraliste peut préciser qu’il pratique des sutures, des immobilisations (« plâtres »), la pose de dispositif intra utérin, la mesure de la fonction respiratoire… - la ou les orientation(s) particulières de son activité dans le cadre de sa spécialité dès lors que l’intitulé ne prête pas à confusion avec celui d’une autre spécialité médicale.
Par exemple, un médecin généraliste ou spécialiste en médecine physique et de réadaptation pourra indiquer que sa pratique est orientée en médecine du sport. Un médecin spécialiste en psychiatrie pourra indiquer sa pratique de l’addictologie. -
quel est son exercice professionnel, qu’il soit exclusif, quasi exclusif ou limité dans le cadre de sa spécialité, en s’inspirant des indications prévues dans le répertoire opérationnel des ressources (ROR) proposées dans chaque discipline par le conseil national professionnel compétent (CNP) et le Conseil national de l’Ordre des médecins.
Par exemple, cardio-pédiatrie, gynécologie cancérologique, chirurgie du membre inférieur, pneumo-allergologie, chirurgie de l’épaule, chirurgie coelioscopique… -
les techniques utilisées dans le champ de sa spécialité
Exemples : électrocardiogramme (ECG), électromyogramme (EMG), électroencéphalogramme (EEG), échographies… - la participation à des actions de santé publique (prévention, dépistage…) ou à des réseaux de soins (périnatalité, cancérologie…) organisés par des établissements et des professionnels de santé.
A l’occasion de la présentation de son activité et de ses pratiques professionnelles, le médecin peut diffuser, y compris par photos et vidéos, des informations à finalités scientifique, préventive ou pédagogique sur sa discipline et sur les enjeux de santé publique, dans le respect de ses obligations déontologiques, notamment de secret professionnel. L’identification des patients ne doit pas être possible sur les photos et vidéos diffusées. Conformément à l’article R. 4127-13 du code de la santé publique, il ne doit faire état que de données confirmées, avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public et se garder de toute attitude commerciale dans son intérêt et/ou dans celui d’un tiers.
Cette présentation peut comporter des éléments utiles aux patients, de caractère général, y compris par renvoi à des sites internet (voir infra) ou des éléments plus spécifiques.
Il convient que le médecin ne fasse pas état :
- de notations, évaluations, commentaires, remerciements ou témoignages de patients ou de tiers ;
- de photos sur le mode « Avant l’intervention / Après l’intervention » qui ne se limitent pas à présenter les résultats habituellement attendus, dans le but de faire croire à une garantie de résultat ;
- de comparatifs sur les délais de prise en charge, les tarifs ou les actes pratiqués par d’autres médecins ou établissements ;
- de mention valorisant qualitativement ses conditions d’exercice et ses résultats, ou faisant valoir qu’il n’a jamais fait l’objet de plaintes de patients, de poursuites disciplinaires ou de sanctions.
II- Informations quant au parcours professionnel du médecin
Lorsqu’un médecin entend communiquer des informations sur son parcours professionnel, il lui est recommandé de le faire en diffusant les éléments essentiels de son curriculum vitae (cf modèle à titre d’exemple en annexe) en se limitant à ce qui est nécessaire à l’information du public et en relation directe ou indirecte avec son activité professionnelle.
Le médecin peut ainsi diffuser :
- sa photographie ;
- son âge, sa date de naissance et le cas échéant son lieu de naissance ;
- son numéro d’inscription à l’ordre des médecins et autres éléments d’identification ;
- les date, lieu et établissement universitaire de délivrance des diplômes ouvrant droit à l’exercice, éventuellement les stages réalisés pendant la formation ;
- le déroulement de sa vie professionnelle : principaux lieux où il a exercé, les fonctions assurées (fonctions hospitalo-universitaires…), les postes occupés ou titres, les expériences à l’étranger ;
- les missions qui ont pu lui être confiées ;
- les publications réalisées dans des conditions conformes aux standards scientifiques ;
- les langues étrangères parlées ou comprises ;
- l’adhésion à une société savante ;
- les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
III- Informations quant à l'organisation de l’activité du médecin et ses conditions d'exercice
Le médecin doit donner des informations précises sur les diverses conditions pratiques, professionnelles et économiques de son exercice.
1. Informations pratiques
Les principales informations pratiques utiles aux patients sont les suivantes :
- adresse(s) d’exercice et conditions d’accès (géolocalisation, parking, transports…) ;
- conditions d’accessibilité au public, notamment pour les personnes handicapées ;
- les jours et horaires d’exercice ;
- consultations, téléconsultations et visites à domicile ;
- modalités de prise de rendez-vous.
2. Conditions professionnelles d’exercice
Le médecin est invité à :
- expliciter son mode d’exercice : libéral, salarié ou hospitalier…, son lieu d’exercice (cabinet, établissement de santé ou médico-social, maison ou centre de santé…) ;
- indiquer s’il propose des plages horaires pour les soins non programmés.
3. Communication d’informations économiques précises pour la prise de rendez-vous (hors prise de rendez-vous téléphonique)
Le médecin en exercice libéral est tenu de préciser :
- le secteur conventionnel pour lequel il a opté et ce qui en résulte ;
- les honoraires qu’il pratique habituellement (fourchettes) ;
- les modes de paiement acceptés ;
Les modes de paiement doivent rester multiples. Il n’est pas possible d’imposer un seul mode de paiement.
Le médecin doit également rappeler qu’il assure le tiers payant aux personnes bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU), de la complémentaire santé solidaire (CSS), de l’aide médicale d’Etat (AME) et aux victimes d’accident du travail ou maladies professionnelles.
IV- Recommandations spécifiques relatives à la présence du médecin sur internet
Le médecin qui présente son activité sur Internet se doit d’être tout particulièrement attentif à respecter les recommandations qui précèdent, en raison même des facilités de diffusion d’informations et d’accès à celles-ci ainsi permises. Il se doit au surplus de veiller à différents points spécifiques liés à l’usage de l’Internet et pour lesquels les prescriptions ou recommandations suivantes lui sont faites :
- S’interdire toute forme de procédé destiné à obtenir un référencement numérique prioritaire
interdit expressément au médecin, pour ce qui est des annuaires « d’obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur Internet ». Le champ de cette interdiction, du fait même de son contenu et de sa justification, ne saurait être limité aux annuaires, et porte naturellement sur tous les modes d’utilisation de l’Internet par le médecin.
L’attention du médecin doit être appelée sur l’emploi de certains moyens susceptibles de conduire à un référencement.
Ainsi, l’utilisation de hashtags aux fins d’augmenter sa visibilité et de cibler des patients potentiels constitue une stratégie promotionnelle du médecin. Elle doit alors être regardée comme faisant partie des moyens de référencement prioritaires proscrits.
- S’astreindre à une actualisation régulière de l’information délivrée en ligne
Les facilités de l’information par Internet ont une contrepartie, celle de l’obligation pour le médecin de faire en sorte que les informations mises en ligne soient appropriées et actualisées et ne soient pas susceptibles d’induire le public en erreur. Il est dès lors recommandé au médecin de dater les informations mises en ligne, en citant ses sources et références et de les vérifier régulièrement afin de procéder, lorsque cela est nécessaire, à leur mise à jour.
Il est recommandé au médecin de supprimer les informations dont l’obsolescence peut être source d'erreur pour le public ou d'accompagner leur publication des avertissements appropriés.
Devant la difficulté pour le médecin d’assurer lui-même des mises à jour régulières, il lui est vivement recommandé de créer des liens renvoyant vers les sites des autorités publiques ou sanitaires ou des sites officiels d’information en matière de santé.
- S’assurer de la fiabilité des sites d’informations et références auxquels le médecin renvoie au travers d’un lien
Si le médecin souhaite créer des liens vers d’autres sites internet, il lui est recommandé de se limiter à des sites présentant toutes les garanties de fiabilité et d’impartialité, notamment les sites des autorités publiques ou sanitaires, des sociétés savantes ou des sites officiels d’information en matière de santé.
S’il estime devoir renvoyer vers d’autres sites, il doit s’assurer que ces sites soient des sources d’information fiable et non commerciale.
- Redoubler de vigilance en cas d’intervention sur les réseaux sociaux
Il est recommandé au médecin qui intervient en cette qualité sur les réseaux sociaux (facebook, twitter, instagram, youtube…) de faire preuve de prudence et de modération dans ses propos, même s’il le fait en utilisant un pseudonyme.
Il doit rester respectueux des personnes, que celles-ci soient considérées isolément ou en groupe. La tenue de propos diffamatoires, calomnieux, injurieux ou discriminatoires est passible de poursuites judiciaires et disciplinaires.
Il est rappelé que les articles L. 4113-3 et du code de la santé publique interdisent d’exercer la profession de médecin sous un pseudonyme. Si le médecin s’en sert sur internet pour une activité autre que son exercice mais qui comporte des liens avec son art ou sa profession, il est tenu d’en faire la déclaration au Conseil départemental de l’Ordre dont il relève.
recommandé de curriculum vitae d'un médecin sur son site internet
Médecins n°71
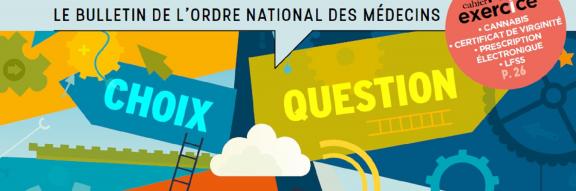


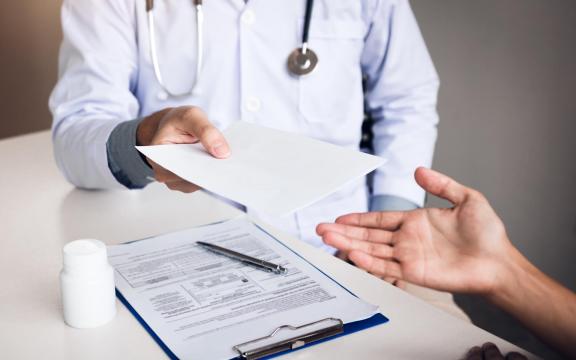


La mention de titres ou diplômes universitaires ne figurant pas dans cette liste doit faire l’objet d’une demande de reconnaissance auprès du Conseil national de l'Ordre des médecins par le coordonnateur du diplôme.
La liste des titres autorisés est disponible sur le site internet de l’Ordre.
Il appartient au Conseil départemental de l’Ordre de s’assurer de l’authenticité des titres présentés par un médecin.
Si les spécialités, titres et diplômes reconnus sont admis pour une information utile, claire et loyale des patients, le texte prohibe les mentions susceptibles de créer dans l’esprit du public une confusion sur les compétences du médecin ou sur une compétence non certifiée.
Certains diplômes délivrés non reconnus par l’Ordre reprennent l’intitulé ou un intitulé proche d’une spécialité ou d’une compétence validée. La mention de ces diplômes est interdite car pouvant tromper le public sur l’exercice, les compétences et la qualification du médecin.
Dans le cadre de son activité professionnelle, le médecin peut faire état de distinctions honorifiques reconnues par la République française, mais il lui est interdit d’usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux, fantaisistes ou illusoires.