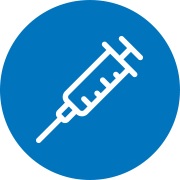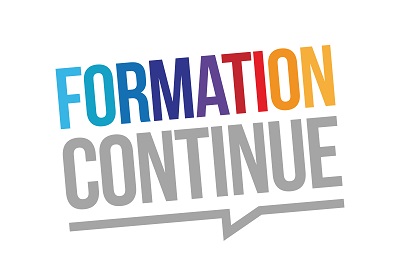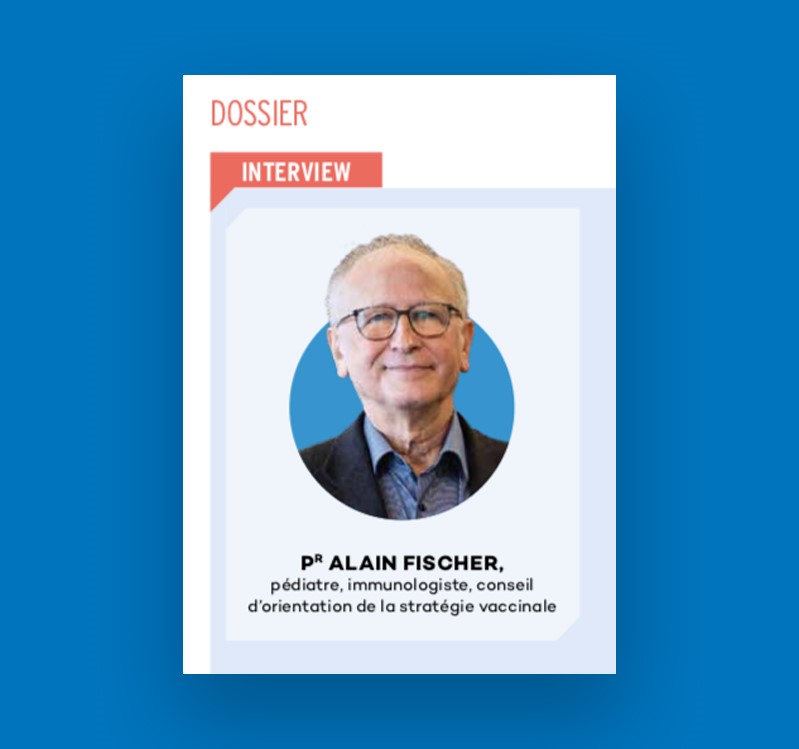Brève Covid 15

Newsletter de mai 2021

À la Une
Covid-19 : l’Ordre offre aux médecins un espace de dialogue
Le 18 mai, le Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom) a organisé une session de questions-réponses en visioconférence en live avec le Dr Patrick Bouet, président du Cnom et le Pr Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale anti Covid-19.
Avec plus de 16 000 médecins connectés, et plusieurs milliers de questions envoyées, la visioconférence a rencontré un vif succès. L’objectif de cet événement : accompagner au mieux l’engagement des médecins dans la campagne de vaccination, en offrant un espace d’échanges et de dialogue entre les médecins et le Pr Alain Fischer.
Fiabilité, recommandations formulées pour les différents vaccins, notamment Astra Zeneca, choix quant à la stratégie vaccinale, vaccinations hétérologues, efficacité sur les différents variants, approvisionnement, déconfinement… pendant près d’une heure et demie le Pr Fischer et le Dr Bouet ont répondu sans détour aux questions des médecins. « Vous médecins, avez déjà et allez avoir un rôle essentiel dans les semaines qui viennent. Vous êtes sans doute les mieux placés pour convaincre et expliquer à nos concitoyens qu’il est essentiel de se vacciner » a rappelé le Pr Fischer. « Dans le cadre de la vaccination, si nous sommes aujourd’hui à cet état de succès de la campagne de vaccination, c’est aussi parce que les médecins ont été au premier plan. Ils ont joué un rôle important dans la pédagogie, dans l’accompagnement à la décision vaccinale. Et sans cette mobilisation sans précédent du corps sanitaire français, le pari politique n’aurait pas pu être gagné », a conclu le Dr Bouet.
Le chiffre du mois
10 656 778 Français sont désormais vaccinés contre le virus de la Covid-19 (ayant reçu toutes les doses nécessaires de vaccin), soit près de 16% de la population, avec un rythme moyen d’environ 100 000 personnes supplémentaires chaque jour.
Source : Ministère des Solidarités et de la Santé
Actus
Sévices : comment appliquer la dérogation permissive au secret
Suite à la loi visant à protéger les victimes de violences conjugales votée en juillet 2020, les
Crise sanitaire : repérer ses impacts sur la santé des enfants
Réussir ensemble « Mon espace santé »
Courant juillet, la phase pilote de « Mon espace santé » va être lancée dans les départements de la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique et la Somme. « Mon espace santé » est un espace numérique individuel mis à la disposition par l’État et l’Assurance Maladie pour permettre à chaque citoyen de stocker ses informations médicales et les partager avec les professionnels de santé qui les soignent. Ouvert à l’ensemble de la population française à partir de janvier 2022, Mon espace santé doit permettre à l’assuré de mieux se soigner ou de mieux être soigné en s’impliquant dans la gestion et le partage de ses informations et documents. À partir de janvier 2022, chaque citoyen pourra utiliser le service Mon espace santé en se connectant au site monespacesante.fr. Cet espace abrite notamment le DMP, un agenda de santé, une messagerie sécurisée ainsi qu’un accès à une sélection d’applications certifiées par l’État.+ d’infos :
À découvrir
DPC : validation de la période 2020-2022
Bien que la période actuelle de DPC ne s’achève qu’en décembre 2022, pensez à conduire dès que possible vos formations validantes. Vous pouvez remplir votre obligation de DPC avec l’aide de votre Conseil National Professionnel (CNP) qui vous indiquera les modalités possibles au sein des différents parcours de DPC qu’ils ont élaborés, et pourra vous apporter tout le concours et les conseils nécessaires. C’est également lui qui vous délivrera l'attestation de conformité, véritable sésame du parcours de formation médicale.
En images
Retrouvez la visioconférence du Pr Alain Fischer
L’enregistrement de la visioconférence organisée le 18 mai par l’Ordre des médecins avec le Pr Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale anti Covid-19 (cf. article À la Une) est disponible sur la chaîne Youtube du Conseil national de l’Ordre des médecins.En veille
Le calendrier vaccinal 2021
La Semaine Européenne de la Vaccination (SEV) vient de se terminer, c’est l’occasion de rappeler que le ministère des Solidarités et de la Santé a publié le nouveau . Parmi les évolutions : l’extension de la vaccination contre les HPV aux garçons de 11 à 14 ans révolus avec un rattrapage vaccinal pour ceux âgés entre 15 et 19 ans révolus (applicable depuis le 1er janvier 2021), et un calendrier complémentaire « Covid-19 ».La Cnil publie son rapport d’activité 2021
Impact de la crise sanitaire, nouvelles règles sur les cookies, cybersécurité et souveraineté numérique : dans sonReplay de la visioconférence avec le Pr Fischer

Vous avez été 16 000 à vous connecter, retrouvez le replay de cette visioconférence
Brève Covid 14

Visioconférence sur la stratégie vaccinale

Face aux évolutions régulières de la campagne de vaccination, l’Ordre des médecins est conscient des difficultés auxquelles les médecins sont confrontés quotidiennement. Soucieux de faciliter leur exercice et d’accompagner au mieux leur engagement dans cette période cruciale, le Conseil national a décidé d’inviter l’ensemble des médecins à dialoguer avec le Pr Alain Fischer, Président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, lors d’une visioconférence organisée le mercredi 5 mai 2021 à 20 heures.
Pleinement engagés dans la lutte contre la pandémie, les médecins font régulièrement part de leur désarroi, voire de leur incompréhension, devant les évolutions de la campagne vaccinale, au gré des annonces des autorités scientifiques et du gouvernement.
Ces inflexions sont source d’une confusion certaine pour nos concitoyens, mais aussi pour les médecins, sans cesse confrontés à des questionnements scientifiques (espacement de 42 jours entre les deux injections de Pfizer et Moderna, restrictions liées au vaccin AstraZeneca, vaccination d’un même patient avec deux vaccins différents…) et des défis logistiques (tensions d’approvisionnement, organisation des rendez-vous, difficultés parfois face à une défiance vis-à-vis du sérum AstraZeneca, y compris chez les plus de 55 ans ayant déjà reçu une première dose…).
Depuis plusieurs mois maintenant, le Conseil national n’a cessé d’oeuvrer en alertant les pouvoirs publics sur la nécessité de clarifier la stratégie vaccinale, d’en informer les professionnels de santé dans la plus grande transparence, et de les y associer.
Soucieux de faciliter l’exercice des médecins et de les accompagner au mieux, l’Ordre souhaite aujourd’hui jouer un rôle de médiateur avec les autorités scientifiques, sans s’y substituer. C’est pourquoi il a invité l’ensemble des médecins à participer à une visioconférence avec le Pr Alain Fischer, Président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, le mercredi 5 mai 2021 à 20 heures.
Les médecins peuvent dès à présent transmettre leurs questions via une adresse mail dédiée qui leur a été transmise, ou les réserver pour le jour de l’événement. Le Pr Fischer y répondra en direct.
Les échanges pourront être visionnés en replay sur la chaîne YouTube de l’Ordre les jours suivants.
Malgré les difficultés et les incertitudes, l’Ordre entend soutenir et encourager les médecins à poursuivre leur mobilisation, à tenir bon pour nos concitoyens et notre pays. Alors que le virus a déjà fait plus de 100 000 victimes et que la situation sanitaire reste très préoccupante, seule une vaccination massive permettra de lever progressivement les mesures restrictives, de redonner à nos concitoyens leurs libertés, et de dessiner des jours meilleurs pour notre société.
Validation triennale du DPC

- Les Conseils Nationaux Professionnels (CNP), le Collège de la Médecine Générale (CMG) et la Fédération des Spécialités Médicales (FSM).
- L’Agence Nationale du Développement Professionnel Continu (ANDPC) et le Haut Conseil du Développement Professionnel Continu (HCDPC).
- L’hébergement final, la validation et le contrôle (éventuellement en appel) au Conseil national de l’Ordre des médecins ;
- Pour l’Agence Nationale du Développement Professionnel Continu (ANDPC) : d’une part l’organisation du DPC relevant des actions prioritaires, et d’autre part la mise à disposition de chaque professionnel de santé, quels que soient son statut et son mode d'exercice, sur le site internet de l'Agence Nationale du Développement Professionnel « d’un document de traçabilité électronique » permettant d’accueillir la synthèse des actions réalisées par les médecins. Ce document peut héberger idéalement une attestation de conformité du Conseil National Professionnel (CNP) ou du Collège de la Médecine Générale (CMG) ou une accréditation de la Haute Autorité de Santé (HAS).
- En l’état actuel des textes, ces documents ne peuvent être nominalement transmis qu’entre l’Agence Nationale du Développement Professionnel Continu (ANDPC) et le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) après que le médecin ait coché la case d’autorisation de transmission des données au Conseil national de l’Ordre des médecins, chaque année et au terme de la période de trois ans.
- Lien pour accéder au document de traçabilité :
- Bien entendu, les Conseil Nationaux Professionnels (CNP) ont un rôle désormais essentiel dans la définition et la délivrance de l’attestation de conformité du parcours de formation. Ils doivent être présents dans la démarche du DPC chaque fois que le médecin le souhaite.
- Et la loi précise que « L'ensemble des actions réalisées par les professionnels au titre de leur obligation de développement professionnel continu sont retracées dans un document dont le contenu et les modalités d'utilisation sont définis par le conseil national professionnel compétent au titre de leur métier ou de leur spécialité. »
- Pour vous permettre de communiquer avec eux, les CNP mettront prochainement à votre disposition, une plateforme d’échanges de données entre vous et votre Conseil National Professionnel (CNP), permettant d’obtenir l’attestation de conformité
- Le Collège de Médecine Générale :
- Votre Conseil National Professionnel soit directement, soit par l’intermédiaire de la Fédération des Spécialités Médicales :
Pour cette dernière période (2020-2022), vous pourrez remplir votre obligation avec l’aide de votre Conseil National Professionnel (CNP) qui vous indiquera les modalités possibles au sein des différents parcours de DPC qu’ils ont élaborés.
Pour rappel il existe trois façons de remplir cette obligation de DPC (R.4021-4 du Code de la santé publique) en notant que les deux premières sont automatiquement validées par l’Ordre :
- L’accréditation par la Haute Autorité de Santé (HAS) qui vaut DPC.
- L’Obtention d’une attestation de conformité par votre Conseil National Professionnel (CNP) en suivant ses recommandations de parcours de DPC. Ce parcours peut inclure différentes « actions » reconnues et détaillées par chaque Conseil National Professionnel (CNP).
- Il existe enfin une troisième voie qui est celle d’un « parcours libre » au choix du Médecin (R.4021-4 du Code de la santé publique) qui devra être validé par le Conseil national de l’Ordre des médecins.
Concernant la période précédente (2017-2019), les documents d’ores et déjà transmis aux Conseils départementaux de l’Ordre des médecins, ainsi que ceux transmis actuellement au moyen du Document de Traçabilité par l’Agence Nationale du Développement Professionnel Continu (ANDPC) au Conseil national de l’Ordre des médecins, seront conservés dans vos dossiers administratifs et espaces numériques ( ) pour faire valoir de cette obligation.
Newsletter d'avril 2021

À la une
Le Pr Alain Fischer répond à toutes vos questions sur la stratégie vaccinale
L’Ordre des médecins entend aujourd’hui jouer un rôle de médiateur entre les médecins et les autorités scientifiques. L’institution vous convie, mercredi 5 mai à 20 heures, à participer à une visioconférence avec le Pr Alain Fischer, président du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale.Alors que la France compte désormais plus de 100 000 victimes de la pandémie, parmi lesquelles un grand nombre de soignants, le virus et ses variants continuent de circuler activement. Mobilisé à tous ses échelons, l’Ordre des médecins est conscient des difficultés majeures qui sont celles des médecins, pleinement impliqués dans la campagne vaccinale. Les changements permanents de stratégie, au gré des annonces des autorités scientifiques et du gouvernement, sont source d’une grande confusion, pour vous comme pour vos patients.
Le Conseil national de l’Ordre n’a eu de cesse, depuis plusieurs mois, d’alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de clarifier cette stratégie auprès des professionnels de santé. Soucieux de vous accompagner au mieux et de faciliter votre exercice, l’Ordre des médecins entend aujourd’hui jouer un rôle de médiateur et vous convie, le 5 mai prochain à 20 heures, à participer à une visioconférence durant laquelle vous pourrez dialoguer avec le Pr Alain Fischer, président du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale.
Vous pouvez dès à présent lui poser toutes vos questions par mail, à l’adresse , ou les réserver pour le jour de l’événement, en les écrivant dans le tchat interactif auquel vous aurez accès. Le Pr Fischer y répondra en direct. Le lien de connexion vous sera transmis le lundi 3 mai prochain.
Si vous ne pouviez pas vous y connecter, un replay sera mis en ligne sur notre chaîne Youtube les jours suivants.
Pour poser toutes vos questions au Pr Alain Fischer :
Le chiffre du mois
Actus
Téléconsultations dans les supermarchés
Ayant appris l’ouverture, par une enseigne de grande distribution, de cabines de téléconsultation au sein même de supermarchés, l’Ordre des médecins rappelle avec fermeté que, selon le code de la santé publique, « la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ». Par ailleurs, la téléconsultation doit être inscrite dans le parcours de soins coordonnés. La prise en charge de patients exclusivement en téléconsultation porte atteinte aux exigences déontologiques de qualité, de sécurité et de continuité des soins. L’Ordre appelle le gouvernement à réagir avec fermeté pour protéger l’acte médical au service des patients.Pour lire le dans son intégralité.
Pour consulter les derniers rapports de l’Ordre sur les .
Tact et mesure : le code de déontologie actualisé
L’article 53 du code de déontologie médicale, relatif aux honoraires, a été enrichi de . Cela fait suite à la publication d’un, relatif aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux. Le texte précise le barème de sanction applicable par l’Assurance maladie concernant ces dépassements. Jusqu’ici, les commentaires de l’article 53 mentionnaient les critères ordinaux d’appréciation du tact et de la mesure. Ceux de l’Assurance maladie étant différents, l’Ordre a réécrit les commentaires du code de déontologie pour guider les médecins dans l’application de ces nouvelles dispositions.Vaccination : l’Ordre mobilisé, partout en France
L’Ordre des médecins est pleinement mobilisé aux côtés des médecins dans la campagne vaccinale contre la Covid-19. Les conseils départementaux et régionaux ont ainsi mis en œuvre ou ont participé à des initiatives visant à organiser le déploiement de la campagne dans les territoires, partout en France. Mise en place de centres de vaccination pour les professionnels de santé, sollicitation des médecins actifs ou retraités à participer à la campagne, déploiement d’unité mobile de vaccination… Les initiatives sont nombreuses et variées. Retrouvez-les surÀ découvrir
L’entretien avec le Pr Alain Fischer sur la vaccination
En images
L’entraide ordinale reste pleinement mobilisée
Le 0800 288 038, numéro d’écoute et d’assistance aux médecins, internes et professionnels de santé est gratuit. Il peut être joint 24h/24 et 7j/7 en cas de besoin. Le Dr Jacques Morali, délégué général aux relations internes au Cnom et responsable de l’entraide entre 2017 et 2019, détaille ce service d’aide globale qui peut intervenir sur des problèmes d’ordre personnel, familial, professionnel et social.En veille
Ségur de la santé : une série de mesures adoptées
La loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification vient d’être publiée auViolences : remise de certificats aux victimes
, daté du 31 mars 2021, précise les modalités de remise des certificats médicaux réalisés sur réquisitions judiciaires aux victimes de violences, notamment conjugales. Ce texte fait suite à l’adoption de la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales. Il précise que la remise d'une copie du certificat médical à la victime se fait à sa demande. « Lorsque le médecin requis rédige son certificat immédiatement à l'issue de son examen, il en remet une copie à la victime si celle-ci le lui demande. Lorsque le certificat est rédigé ultérieurement, il peut en adresser la copie à la victime si celle-ci en a fait la demande. » Cette remise peut être réalisée par tout moyen, y compris par voie dématérialisée.Téléconsultations dans les supermarchés

L'Ordre demande au Gouvernement de réagir pour protéger l’acte médical et les patients.
Ayant appris l’ouverture, par une enseigne de grande distribution, de cabines de téléconsultation au sein même de supermarchés, l’Ordre des médecins rappelle avec fermeté que, selon l’article R.4127-19 du code de la santé publique, « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. »
Engagé de longue date pour que la télémédecine et la téléconsultation soient concrètement intégrées dans les parcours de soins des patients et les pratiques quotidiennes des médecins, notamment par une simplification de la réglementation, l’Ordre des médecins rappelle par ailleurs que la téléconsultation doit être inscrite dans le parcours de soins coordonnés. L’avenant n°6 à la convention médicale prévoit en effet clairement que la téléconsultation n’est prise en charge par l’Assurance maladie que lorsqu’elle est effectuée dans le parcours de soins défini par la loi et la convention médicale.
L’Ordre rappelle à cet égard qu’il ne peut être accepté qu’un médecin prenne en charge un patient sans possibilité de procéder à un examen clinique chaque fois que cela est souhaitable; sans aucun ancrage territorial ni aucune connaissance du tissu sanitaire et médico-social; sans se préoccuper de son parcours de soins et sans apporter une garantie que la continuité des soins pourra être assurée. La prise en charge de patients exclusivement en téléconsultation porte atteinte aux exigences déontologiques de qualité, de sécurité et de continuité des soins.
Les cabines de téléconsultation ouvertes dans l’enceinte de supermarchés semblent, dans la promotion qui en a été faite par voie de presse, contrevenir à ces obligations et être portées par des opérateurs de télémédecine, hors parcours de soins. Le conseil national de l’Ordre des médecins, qui a régulièrement appelé à une régulation des offres de télémédecine par des sociétés intermédiaires à vocation commerciale, souligne une nouvelle fois que celles-ci ne sauraient s’affranchir du contrat social français.
L’Ordre regrette d’autant plus cette annonce que l’expérience de cette première année de crise sanitaire a cruellement mis en évidence les trop nombreux dépistages et consultations suspendues du fait de la pandémie. La découverte à des stades parfois avancés de pathologies graves justifie a posteriori la nécessité d’un examen présentiel et d’un examen clinique, plus que jamais fondamentaux à ce jour, sans nier ce que la télémédecine a pu apporter par ailleurs.
L’Ordre des médecins, face à cette nouvelle annonce en contradiction directe avec l’organisation de notre système de santé, appelle le Gouvernement à réagir avec fermeté pour défendre les principes régissant l’organisation des soins en France, et pour protéger l’acte médical au service des patients.
Brève Covid 13

Brève Covid 12