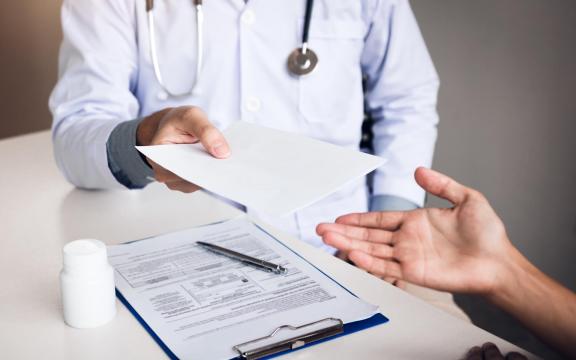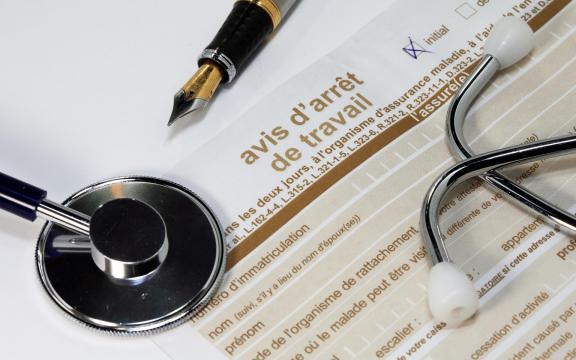Temps de lecture : 3 mn

La commission jeunes médecins réunit conseillers nationaux et représentants des jeunes pour échanger sur la formation et l'avenir du métier.
Le Conseil national de l'Ordre des médecins rencontre régulièrement les représentants des étudiants en médecine, des internes, des chefs de clinique et des jeunes diplômés. Avec un objectif majeur : prendre connaissance de leurs souhaits et de leurs attentes et échanger avec eux sur des sujets d’actualité comme la mise en œuvre de la réforme du 3ème cycle, l'installation, les difficultés de l'internat, etc.
Les rapports de la commission jeunes médecins
Voir aussi sur les jeunes médecins et la médecine de demain.
Des structures d'internes ou d'étudiants
Cette commission comprend un président et huit membres élus par le conseil national ainsi que sept autres membres : un représentant par structure nationale représentative des étudiants en médecine, des internes, des chefs de clinique et des jeunes diplômés. Sept structures de jeunes médecins sont représentées au sein de la commission :- Syndicat jeunes médecins
- - Inter Syndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale
- - InterSyndicale Nationale des Internes
-
- Regroupement Autonome des Généralistes Jeunes Installés et Remplaçants - - Syndicat des internes des Hôpitaux de Paris
- - Syndicat National des Jeunes Anesthésistes Réanimateurs
Trois thèmes de travail prioritaires
La commission est structurée en groupes de travail thématiques qui se réunissent régulièrement tout au long de l’année. Parmi les thématiques prioritaires :- L’environnement social des jeunes médecins. Il s’agit d’aborder les questions d’égalité hommes-femmes (déroulement des carrières, harcèlement…), la prévention des risques psycho-sociaux (mal-être, suicide…), la protection sociale (congé parental, maladie…). Un groupe a également travaillé en lien avec la commission d’entraide du Cnom.
- La communication. La commission réfléchit, en lien avec la conférence des doyens, à la création d’une formation en ligne (Mooc) sur les grands principes de déontologie médicale.
- L’accès aux soins et l’installation. Pour casser les idées reçues et les préjugés sur la vision qu’ont les jeunes médecins de l’exercice libéral, la commission a lancé une vaste enquête sur les déterminants et les freins à l’installation chez les jeunes médecins. Cette enquête a été envoyée début 2019 aux jeunes médecins. Ces rencontres ont fait émerger des préconisations qui feront l’objet d’un rapport. Il servira de feuille de route pour le Conseil national de l'Ordre des médecins pour les 3 prochaines années.
Les rapports de la commission jeunes médecins
Cette enquête de la commission jeunes médecins du Cnom porte sur les déterminants et les freins à l'installation.
Ce statut de « médecin-assistant de territoire » permettrait aux jeunes médecins d’approfondir leurs projets d’exercice professionnel, de faciliter leur insertion dans le maillage territorial de l’offre de soins, d’encourager leur installation définitive. Ce statut de « médecin-assistant de territoire » contribuerait, tout en permettant aux jeunes médecins de construire leurs projets professionnels en harmonie avec leur choix de vie personnelle, de remplir une mission de service public rémunérée comme telle et une mission d’accès aux soins rémunérée comme professionnel libéral.
La commission jeunes médecins du conseil national de l'Ordre des médecins a mené une enquête inédite sur la santé des jeunes médecins.
Voir aussi sur les jeunes médecins et la médecine de demain.
Mise en relation des fichiers Hopsyweb et FSPRT
Temps de lecture : 2 mn

L'Ordre examine la possibilité d’un recours au Conseil d’Etat suite au décret autorisant la mise en relation des fichiers dits Hopsyweb et FSPRT.
Après la parution au Journal officiel d’un
Garant des principes fondamentaux de l’exercice professionnel, en particulier celui du secret médical, le Conseil national de l'Ordre des médecins avait déjà déposé, en juillet 2018, un recours devant le Conseil d’Etat au sujet du dispositif Hopsyweb relatif au suivi des soins sans consentement. Il y interrogeait notamment l’accès aux données personnelles par des personnes désignées par le ministère de la Santé et la durée de conservation des données.
L’Ordre des médecins tient à réaffirmer la nécessité de préserver le caractère absolu du secret médical, qu’il considère comme une condition sine qua non de la relation de confiance entre un patient et son médecin. Conscient des enjeux liés à la prévention de la radicalisation, il rappelle que la législation permet des exceptions au secret professionnel en cas de danger imminent et préconise une stricte application des textes législatifs en vigueur.
Garant des principes fondamentaux de l’exercice professionnel, en particulier celui du secret médical, le Conseil national de l'Ordre des médecins avait déjà déposé, en juillet 2018, un recours devant le Conseil d’Etat au sujet du dispositif Hopsyweb relatif au suivi des soins sans consentement. Il y interrogeait notamment l’accès aux données personnelles par des personnes désignées par le ministère de la Santé et la durée de conservation des données.
L’Ordre des médecins tient à réaffirmer la nécessité de préserver le caractère absolu du secret médical, qu’il considère comme une condition sine qua non de la relation de confiance entre un patient et son médecin. Conscient des enjeux liés à la prévention de la radicalisation, il rappelle que la législation permet des exceptions au secret professionnel en cas de danger imminent et préconise une stricte application des textes législatifs en vigueur.
Temps de lecture : 0 mn

Pourquoi utiliser les messageries sécurisée lors des échanges entre professionnels de santé ? En quoi consiste la sécurisation ? Quelles évolutions ?
Temps de lecture : 0 mn

Propositions du groupe de travail de l'Ordre des médecins et des Doyens des Facultés de médecine dans le cadre de l'Initiative Territoire.
Temps de lecture : 0 mn

Améliorer l'offre de soins : Initiatives réussies dans les territoires (rapport de l'Ordre de 2016)
Temps de lecture : 6 mn

Le médecin accompagne la personne en fin de sa vie en s’efforçant de soulager le mieux possible la souffrance par des moyens appropriés à son état.
Le médecin doit également sauvegarder la dignité du patient. Depuis la loi Leonetti de 2005, qui interdit l’obstination déraisonnable, il peut utiliser des traitements sédatifs pour répondre à une souffrance réfractaire, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie Les droits des patients ont été renforcés par la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Le point sur les dispositions en vigueur…
Le cadre légal et déontologique
La- le droit de refuser un traitement ;
- le droit de bénéficier du meilleur apaisement possible de la souffrance ce qui peut impliquer la mise en place de traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à une souffrance réfractaire en fin de vie, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie ;
- l’interdiction de l’obstination déraisonnable ;
- la possibilité de ne pas entreprendre ou d’interrompre les actes qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ;
- le droit de bénéficier de soins palliatifs et d’un accompagnement.
Cette loi renforce le rôle et la place du patient dans les décisions. Elle rappelle que toute personne a le droit de recevoir sur l’ensemble du territoire les traitements, les soins les plus appropriés et le meilleur apaisement possible de la souffrance (cf art. L1110-5 et L.1110-5-3 CSP).
Elle prévoit la rédaction de directives anticipées pouvant s’imposer au médecin ;
Elle autorise l’arrêt ou la limitation de traitements qui constitueraient une obstination déraisonnable, soit à la demande du patient en état d’exprimer sa volonté, soit, s’il est inconscient, sur décision du médecin à l’issue d’une procédure collégiale ;
Elle permet le recours à une sédation profonde et continue jusqu’au décès dans des situations particulières.
Le conseil national de l'Ordre des médecins a mis à jour les commentaires des articles 37 à 37-4 du code de déontologie médicale (articles R.4127-37 à R.4127-37-4 du code de la santé publique).
Par ailleurs, le
Le conseil national de l’Ordre des médecins a conçupicture_as_pdf
Le refus de l’obstination déraisonnable
La loi précise que le médecin doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable. L’établissement de l’obstination déraisonnable suppose la prise en compte d’éléments de nature médicale (notamment inutilité des actes médicaux, leur disproportion ou le fait que ces actes n’ont pas d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie) et d’éléments de nature non médicale relatifs notamment à a volonté que le patient peut avoir antérieurement exprimée. DesLes directives anticipées
Dans le cas où le patient en fin de vie n’est pas en état de s’exprimer, le médecin doit rechercher s’il a rédigé desAujourd’hui, les directives anticipées ont un caractère contraignant. Cependant, elles ne s’imposent que si elles sont appropriées à la situation médicale du patient. Quoi qu’il en soit, la décision d’appliquer, ou à l’inverse, de ne pas appliquer les directives anticipées d’un patient est prise dans le cadre d’une procédure collégiale.
La sédation profonde et continue jusqu’au décès
Une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements peut être mise en œuvre à la demande du patient dans les situations si les 3 conditions suivantes sont réunies :- Le patient est atteint d’une affection grave et incurable ;
- Son pronostic vital est engagé à court terme ;
- Il présente une souffrance réfractaire aux traitements ou sa décision d’arrêter un traitement risque d’entraîner une souffrance insupportable.
Pour la mise en oeuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès, les professionnels de santé s’appuient sur les recommandations de la
Temps de lecture : 6 mn

La téléconsultation a un cadre réglementaire assoupli depuis 2018. Elle doit répondre à certaines conditions réglementaires déontologiques.
Le
Le cadre légal et réglementaire
Les modalités de mise en œuvre des activités de télémédecine ont été redéfinies dans le décret du 13 septembre 2018 afin de libéraliser et de généraliser le développement de la télémédecine ; celle-ci n’est plus soumise à l’obligation d’une contractualisation avec l’ARS, à l’inscription dans un CPOM…etc. Le Conseil national de l’Ordre s’en félicite même s’il déplore que les offres de télémédecine en dehors du parcours de soins ne fassent plus l’objet d’aucune régulation d’aucune sorte.La téléconsultation est donc ouverte à tous les médecins quels que soient leur spécialité, leur mode d’exercice (libéral, salarié ou hospitalier), leur place dans le parcours de soins (médecin traitant et médecin de second recours) et leur secteur conventionnel. Le médecin doit être inscrit au Tableau de l’Ordre ou être en situation de remplacement dans les conditions réglementaires requises
Par ailleurs, l’avenant n°6 à la convention médicale et la
Ainsi un nouvel acte intitulé « Consultation à distance réalisée entre un patient et un médecin dit “téléconsultant” » a été inscrit par l’UNCAM à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels. Sa cotation est TCG pour les médecins généralistes et TC pour les autres médecins spécialistes.
Les téléconsultations sont facturées suivant les tarifs en vigueur pour les consultations présentielles (majorations comprises).
La téléconsultation sera prise en charge comme une consultation classique : 70 % remboursés par l’Assurance Maladie et 30 % remboursés par la complémentaire (prise en charge à 100 % pour les soins concernant des affections longue durée).
Des règles déontologiques spécifiques
La télémédecine est une forme de pratique médicale comme les autres. Sa spécificité est de faire appel aux technologies numériques : toutes les règles déontologiques de prise en charge d’un patient s’y appliquent. Le médecin téléconsultant est libre de décider de la pertinence ou non du recours à la téléconsultation : son indépendance professionnelle reste entière.Des règles déontologiques spécifiques à la télémédecine doivent être observées :
- le médecin devra s’assurer du consentement de son patient à la téléconsultation, après l’avoir informé de ses modalités techniques ;
- au regard de la confidentialité des échanges avec le patient, il devra veiller à la sécurisation des moyens utilisés pour la vidéotransmission ainsi que pour toute communication et transmission de documents pendant et à l’issue de la téléconsultation (résultats d’examens, données d’imagerie, ordonnances antérieures, prescription médicale, etc.) ;
- enfin, toute publicité à caractère commercial pour des offres de soins est interdite par le code de la santé publique, y compris bien sûr lorsqu’il s’agit de télémédecine ;
- à savoir : les vidéos des téléconsultations ne doivent pas être conservées.
L’Ordre des médecins recommande que tous les échanges (conversation, interrogatoire médical, échange de documents) fassent appel à un moyen unique de connexion sur une base sécurisée qui aura les caractéristiques d’un cabinet médical virtuel.
Les prescriptions à l’issue de la téléconsultation
Si une prescription est réalisée à l’issue de la téléconsultation, elle pourra soit être déposée électroniquement dans un espace sécurisé où le patient la récupérera, soit lui être adressée par courrier.Le parcours de soins
Le principe retenu par l’avenant n°6 est celui de téléconsultations inscrites dans le parcours de soins coordonnés. L’avenant précise en effet clairement que la téléconsultation n’est prise en charge par l’Assurance maladie obligatoire que lorsqu’elle est effectuée dans le parcours de soins défini par la loi et la convention médicale.Le patient doit être connu du médecin téléconsultant (médecin traitant ou médecin de second recours) ce qui implique, dans les conditions fixées par l’avenant n°6, au moins une consultation physique au cours des 12 derniers mois précédant la téléconsultation. Les exceptions au parcours de soins s’appliquent aux téléconsultations : accès direct spécifique pour certaines spécialités, patient âgé de moins de 16 ans, urgence…).
Ce principe est essentiel pour le conseil national de l’Ordre des médecins qui dénonce
Les organisations territoriales
L’avenant n°6 pose une exception à ce principe notamment lorsque les patients ne disposent pas de médecin traitant désigné.Dans ce cas, le recours aux téléconsultations est assuré dans le cadre d’organisations territoriales telles que équipes de soins primaires, maisons de santé pluri professionnelles, centres de santé, communautés professionnelles territoriales de santé, ainsi que toute organisation validée par les commissions paritaires locales pour leur capacité à proposer aux patients un suivi médical qui ne se réduise pas à des actes ponctuels de télémédecine. Ces organisations territoriales devront être référencées par les CPAM et portées à la connaissance des patients.
Les obligations de la plateforme de télémédecine
Lorsque vous décidez d’utiliser une plateforme de télémédecine à l’occasion de votre activité, vous devez vous assurer que le prestataire (qui met à votre disposition cette plateforme et qui est votre sous-traitant), respecte la réglementation.Le contrat de sous-traitance doit bien indiquer que le sous-traitant :
- ne traite les données à caractère personnel que sur votre instruction ;
- veille à la signature d’engagements de confidentialité par le personnel ;
- prend toutes les mesures de sécurité requises ;
- ne recrute pas de sous-traitant sans votre autorisation écrite préalable ;
- coopère avec vous pour le respect de vos obligations en tant que responsable de traitement, notamment lorsque des patients ont des demandes concernant leurs données ;
- supprime ou vous renvoie l’ensemble des données à caractère personnel à l’issue des prestations ;
- collabore dans le cadre d’audits.
→ Je m’assure que le prestataire de télémédecine choisi est bien conforme avec la réglementation.
→ Je vérifie la présence des mentions obligatoires dans son contrat.
→ Je contrôle que le patient a bien été informé.
Propositions du groupe Initiatives territoires
Temps de lecture : 0 mn
Propositions de l'Ordre des médecins et de la Conférence de Doyens de médecine pour faire évoluer la formation des jeunes médecins.
Temps de lecture : 1 mn
Le patient a le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne.
La consultation des informations sur place est gratuite. Si le patient souhaite la remise de copies, les frais à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et éventuellement, de l'envoi des documents.
Vous pouvez utiliser les
Vous pouvez utiliser les
Temps de lecture : 5 mn

Vous partez exercer dans un autre département, des démarches sont à effectuer auprès de votre conseil départemental.
Démarches auprès de l’Ordre
Selon l'À noter : vous devez être inscrit dans le département dans lequel vous exercez. Si vous exercez plusieurs activités dans différents départements, vous devez être inscrit au Tableau du département dans lequel vous avez l'activité la plus importante.
Le transfert du dossier
Lorsque, régulièrement inscrit au Tableau, vous désirez transférer votre résidence professionnelle dans un autre département, vous devez :- en aviser le Conseil départemental d’origine et lui demander, par LRAR, votre radiation du Tableau en indiquant l’adresse de votre futur lieu d’exercice ;
Le transfert ne pourra avoir lieu avant votre dernier jour d’exercice dans le département.
- en même temps, adresser au nouveau Conseil départemental une demande d’inscription conformément aux conditions du futur lieu d’exercice.
Dans le cadre de cette instruction, le rapporteur du Conseil départemental de votre nouvelle résidence professionnelle peut être amené à prendre attache avec le Conseil départemental de votre ancienne résidence professionnelle.
Ce n’est qu’à cette double condition que vous pouvez bénéficier des dispositions de l’article
Le Conseil départemental d’origine procède à votre radiation de son Tableau à la date à laquelle vous cessez effectivement votre activité dans le département.
Le Conseil de l'Ordre de votre futur lieu d’exercice statue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande qui peut être prorogé lorsqu'une expertise a été ordonnée.
Tant que vous n’avez pas présenté cette nouvelle demande d’inscription, vous ne pouvez exercer provisoirement dans l’attente de votre nouvelle inscription.
Dans le cas du transfert, si une décision de refus d'inscription est prise à votre encontre, le Conseil départemental en informe les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département.
Lorsque des médecins exerçant en société d’exercice (SCP/SEL) demandent le transfert de leur dossier vers un autre département (ce qii implique préalablement un changement de lieu du siège social de la société), il leur appartient de demander simultanément le transfert de leur société.
Si vous exercez en SCP ou en SEL, il vous faut donc demander le retrait de votre société du Tableau d’origine à la date à laquelle vous entendez effectivement cesser votre activité dans le département.
Vous devez demander simultanément l’inscription de votre société au Tableau du départemental dans lequel vous envisagez de poursuivre votre activité (cf. formulaire de demande d’inscription d’une
En outre, si le transfert de votre activité donne lieu à la conclusion de nouveaux contrats, il vous appartient de les communiquer à votre conseil conformément à l’article L4113-9 du code de la santé publique.
Cotisation ordinale
Si vous formulez votre demande de transfert en cours d'année, assurez-vous d’être à jour du paiement de la cotisation ordinale.Vous êtes redevable de la cotisation ordinale dans le département dans lequel vous étiez inscrit au 1er janvier de l'année en cours. Vous ne réglez la cotisation qu'une seule fois dans l'année. Par conséquent, lorsque vous demandez le transfert de votre dossier, le conseil départemental peut exiger le paiement de votre cotisation pour plus de simplicités administratives. Bien entendu, vous ne paierez rien (pour l'année en cours) dans le département dans lequel vous partez exercer.
Autres démarches pour les libéraux
Attention, selon le lieu où vous projetez de vous installer, les démarches ne sont pas les mêmes. VotreContacter la caisse professionnelle d’assurance maladie (CPAM)
Si vous changez de ville ou de département, contactez la CPAM afin de l’informer de la future adresse de votre cabinet.- soit par téléphone au 0 811 709 075 (0,06€/min + prix d’un appel) où un conseiller vous répondra du lundi au vendredi entre 8h30 à 17h30, soit par la messagerie de votre espace pro
- soit en vous rendant dans la rubrique « Échanges » où votre demande sera prise en compte en 48h.
Prévenir l’Agence régionale de santé (ARS)
Si vous changez de région, informez votre nouvelle Agence régionale de santé. Cette fois-ci, pas besoin de prévenir celle de votre ancienne région. C’est l’Prévenir l’URSSAF
Enfin, pour obtenir votre numéro SIRET, tournez vous vers l’N'oubliez pas par ailleurs de prévenir tous les organismes auxquels vous êtes rattaché (CARMF, impôts etc.).