Newsletter de juin 2019

À la une
L’hôpital sous tension : Grèves dans les services d’urgences
Depuis la mi-mars, et malgré de nombreuses alertes, des grèves hospitalières se multiplient partout en France dans les services d’urgences. Début juin, près de 90 services étaient touchés. Cette crise est l’un des symptômes les plus aigus de l’extrême difficulté dans laquelle se trouve l’hôpital public.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom) a participé, vendredi 12 juin, à la première réunion de la mission nationale pour refonder les urgences, lancée par Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé.
L’Ordre, qui a suivi les évolutions des grèves des médecins et personnels soignants dans les services d’urgences des hôpitaux, avait appelé, dans le cadre du dialogue social, à l’organisation d’une concertation d’urgence impliquant tous les acteurs afin qu’une réponse durable soit apportée aux revendications des professionnels de santé, tant pour le service des patients que pour eux-mêmes. Leur souffrance face aux conditions de travail actuelles doit être entendue. Le député Thomas Mesnier, qui était aux côtés de la ministre durant cette réunion, a indiqué que cette mission aboutirait à la rédaction d’un rapport pour le mois de novembre.
Le Cnom a également pris connaissance des réquisitions préfectorales, notamment à Lons-le-Saulnier, et de l’émotion que les conditions de leur mise en application ont suscitée. La permanence dans les services d’accueil et d’urgences des hôpitaux doit garantir la prise en charge des patients dans les meilleures conditions possible de sécurité. Pour autant, des réquisitions ou l’aggravation des amplitudes horaires de travail des personnels ne sauraient être une solution à la crise majeure que traversent les services d’urgences des hôpitaux. L’Ordre est convaincu que les médecins sont vigilants quant à l’organisation de la permanence et de la continuité des soins et qu’ils organisent leur mouvement dans le respect de l’intérêt premier des patients.
L’Ordre des médecins tient enfin à rappeler qu’il soutient l’ensemble des médecins et professionnels de santé qui exercent près des patients dans des conditions de plus en plus difficiles, et il est prêt à prendre part à l’élaboration des décisions ministérielles qui ne sauraient être différées plus longtemps.
Le chiffre du mois
21 millions de personnes par an se rendent aux « urgences ». Un nombre qui a doublé en vingt ans. 1 patient pris en charge sur 4 vient pour un motif n’ayant pas de caractère d’urgence. La difficulté, dans certains territoires, d’un accès rapide aux soins non programmés en ambulatoire est mise en cause, mais c’est toute l’organisation territoriale (ville-hôpital) des soins qu’il faut revoir.Drees – 2018
Les actus
Le Cnom a un nouveau site Web
Plus moderne, plus fonctionnel et plus intuitif, le site de l’Ordre des médecins a fait peau neuve. Il offre un accès plus simple aux informations avec notamment des entrées par public et par fonctionnalité (« Je suis médecin », « Je suis patient », « Je suis étudiant ou interne », « Documents types et démarches »…), ainsi qu’un moteur de recherche plus performant.Ce nouveau portail met également à la disposition des médecins un espace personnel sécurisé et opérationnel permettant à chaque praticien d’accéder au paiement de sa cotisation en ligne, de gérer ses coordonnées, etc. Conçu en responsive design, le nouveau site du Cnom est consultable depuis un ordinateur, un téléphone ou tout autre appareil mobile. La version actuelle sera enrichie au fil du temps et des besoins.
Violences sexuelles et sexistes : un portail de signalement
Seule une victime sur douze dépose plainte pour des faits de violences sexuelles et sexistes. Pour inverser la tendance, le gouvernement a mis en place unLe projet de loi santé adopté
Le Sénat a adopté mardi 11 juin, le projet de loi Santé porté par Agnès Buzyn, après y avoir inclus de nouvelles mesures pour lutter contre les déserts médicaux. Il a notamment voté un dispositif proposant que la dernière année d'études en 3e cycle de médecine générale (et certaines spécialités déficitaires comme l'ophtalmologie) soit une année de pratique « en autonomie », réalisée en cabinet ou en maison de santé, en priorité dans les zones manquant de médecins. Le Sénat a aussi donné son feu vert à une mesure introduite en commission des Affaires sociales, qui met en place une exonération de cotisations sociales incitative à l'installation rapide des jeunes médecins. Malgré de fortes réticences sur la méthode, le Sénat a habilité le gouvernement à légiférer par ordonnances sur le développement des « hôpitaux de proximité », recentrés sur la médecine générale, la gériatrie et la réadaptation, mais sans maternité, et avec de la chirurgie sur autorisation strictement encadrée.Députés et sénateurs se sont mis d'accord sur une version commune en commission mixte paritaire le 20 juin.
À découvrir
Webzine Santé de l’Ordre des médecins
Le Rapport annuel du Cnom
| , le rapport annuel du Conseil de l’Ordre des médecins est disponible. Il contient tous les faits et chiffres marquants ainsi qu’un panorama sur l’ensemble des activités de l’institution en 2018. |
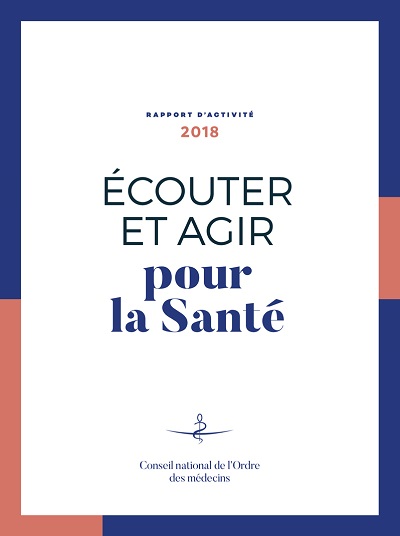 |
Agenda
14 juinRéunion de lancement de la « mission nationale des urgences »
Le Dr François Arnault, délégué général aux relations internes de l’Ordre, a participé à cette première réunion organisée par Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé.
Ministère de la Santé, Paris
20 et 26 juin
Élections au Conseil national de l’Ordre
Le 20 juin le Conseil national de l’Ordre des médecins a été
Cnom, Paris
En image
Vieillissement : le défi de la prise en chargeEn 2050, 5 millions de Français auront plus de 85 ans. Et parmi eux, 1 sur 5 sera en situation de dépendance, psychique ou physique, et aura besoin d’un accompagnement quotidien. Cette vidéo introductive au nouveau Webzine Santé de l’Ordre des médecins, dresse un constat préoccupant…
En veille
Hépatite C : prise en charge simplifiée
La prescription de deux médicaments pour le traitement de l’hépatite C chronique, Maviret® et Epclusa®, deux spécialités pangénotypiques, s’ouvre aujourd'hui à l’ensemble des médecins, notamment aux généralistes, comme prévu par le Plan priorité prévention. Jusqu’à présent réservés à certains spécialistes, il sera possible, à compter du 20 mai 2019, à tout médecin de prescrire ces deux traitements antiviraux à action directe (AAD). Ce parcours simplifié est réservé aux patients atteints de formes non compliquées de l’hépatite C et sans facteur de comorbidités.L’élimination du virus de l’hépatite C en France à l’horizon 2025 est une des mesures phares du Plan priorité prévention 2018-2022. Le renforcement de l’accessibilité aux traitements de l’hépatite C s’articule avec l’intensification des actions de prévention et de dépistages.
L’exercice en multisite simplifié
Le Conseil national publie son rapport d'activité

Au sommaire de ce rapport :
- Les chiffres clés et les faits marquants pour 2018 ;
- Un Ordre engagé dans les débats de société ;
- Un Ordre proche des réalités des territoires ;
- Un Ordre qui conseille, accompagne et agit ;
- Un Ordre ouvert et tourné vers l'avenir ;
- Les bilans financier, social, administratif ;
- Le bilan de la chambre disciplinaire nationale.
Rapport d'activité 2018 du Conseil national de l'Ordre des médecins

Bienvenue sur le nouveau site de l'Ordre des médecins

- De faciliter l’accès à l’information avec une arborescence simplifiée, des entrées par public et par fonctionnalité (« je suis médecin », « je suis patient », « je suis étudiant ou interne », « documents types et démarches », « contact presse » …), ainsi qu’un moteur de recherche plus performant.
- De mettre en exergue les derniers travaux, actualités et prises de position de l’institution, grâce à une page d’accueil totalement repensée.
- D’offrir une navigation plus fluide sur une interface au design moderne et épuré, adaptée aux nouveaux usages des internautes (partage facile et rapide sur les réseaux sociaux, classement des pages les plus vues…).
Conçu en responsive design, le nouveau site du Cnom est consultable depuis un ordinateur, un téléphone ou tout autre appareil mobile.

Force est de constater que la démographie médicale se fragilise dans le département des Pyrénées-Atlantiques et qu’à court terme le renouvellement des médecins généralistes va poser problème.
Suite à ce constat une expérimentation a été menée dans le nord-est du département 64 grâce à un travail collectif qui a associé de nombreux partenaires parmi lesquels le conseil départemental de l’Ordre des médecins.
Résultat : quatre médecins généralistes sont désormais installés dans chacune des maisons de santé de Garlin et de Lembeye. Un an auparavant, on n’en comptait que deux à Lembeye, et Garlin était sur le point de perdre son seul médecin généraliste.
Ce dispositif dont le but est d’attirer les médecins dans le département repose sur une orientation politique unique (gouvernance partagée impliquant l’ensemble des acteurs institutionnels et professionnels du territoire) qui propose un projet de vie professionnel et personnel au médecin généraliste. Les trois axes de cette organisation sont :
- Le cadre de vie : favoriser l’aménagement et l’attractivité du territoire pour les étudiants en médecine et les internes ainsi que pour les médecins et leur famille
- Le cadre d’exercice : privilégier le regroupement des médecins généralistes libéraux, la télémédecine, déployer des consultations avancées et des équipes mobiles de spécialistes dans les territoires sous-dotés, s’appuyer sur les maîtres de stage universitaire pour favoriser l’installation dans le département
- Promouvoir la politique publique départementale sur la Présence médicale

Pour éviter l’écueil de la déshumanisation, l’infirmier est au coeur de la téléconsultation. Sa présence offre un cadre sécurisant.Il accueille le patient, prend les mesures pendant que le médecin, en visioconférence, conduit l’interrogatoire du patient.
Lire le reportage publié dans le picture_as_pdf

Depuis décembre 2018, les patients qui n’ont pas de médecin traitant ou qui ne peuvent pas être reçus rapidement par leur médecin traitant peuvent appeler la cellule de coordination de télémédecine.
Un pool de 11 infirmiers libéraux se relaient ainsi pour accueillir les patients sur le site de Saint-Georges-de-Rouelley et assister les téléconsultations. Les téléconsultations sont assurées par sept médecins, tous basés dans le département et maîtres de stage universitaires.
Grèves dans les services d’accueil des hôpitaux

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a suivi les évolutions des grèves des médecins et personnels soignants dans les services d’urgences des hôpitaux. Il a pris connaissance des réquisitions préfectorales, notamment à Lons-le-Saulnier, et de l’émotion que les conditions de leur mise en application ont suscitée.
La permanence dans les services d’accueil et d’urgences des hôpitaux doit garantir la prise en charge des patients dans les meilleures conditions possibles de sécurité. Pour autant, des réquisitions ou l’aggravation des amplitudes horaires de travail des personnels ne sauraient être une solution à la crise majeure que traversent les services d’urgences des hôpitaux.
L’Ordre des médecins appelle avec gravité, dans le cadre du dialogue social, à l’organisation d’une concertation d’urgence impliquant tous les acteurs afin qu’une réponse durable soit apportée aux revendications des professionnels de santé, tant pour le service des patients que pour eux même. Leur souffrance face aux conditions de travail actuelles doit être entendue.
Le CNOM sait que les médecins seront vigilants quant à l’organisation de la permanence et de la continuité des soins et qu’ils organiseront leur mouvement dans le respect de l’intérêt premier des patients. L’Etat doit néanmoins nécessairement renforcer l’écoute des propositions des praticiens hospitaliers afin de leur permettre de retrouver du temps médical et de ne pas exercer un métier déjà difficile sous la tension permanente d’effectifs insuffisants.
Malgré de nombreuses alertes, des grèves hospitalières se multiplient partout en France. La crise des services d’urgences est l’un des symptômes les plus aigus de l’extrême difficulté dans laquelle se trouve l’hôpital public. L’Ordre des médecins apporte son écoute et son soutien à l’ensemble des médecins et professionnels de santé qui exercent près des patients dans des conditions de plus en plus difficiles, et il est prêt à prendre toute sa part dans l’élaboration des décisions ministérielles qui ne sauraient être plus longtemps différées.

ECN passées il y plus d'un an
J'ai passé mes Épreuves classantes nationales (ECN) il y a plus d'un an et je souhaite m'enregistrer.- Cette démarche n'est possible qu'auprès du CDOM de votre choix sur rendez-vous et muni d'une pièce d'identité :
ECN passées cette année
J'ai passé mes Épreuves classantes nationales (ECN) cette année (civile) et je souhaite m'enregistrer.
Si vous aviez déjà passé les ECN précédemment et que vous vous étiez déjà enregistré à l’Ordre à cette occasion, vous n’avez pas besoin de vous enregistrer à nouveau. Il est donc normal que vous ne receviez pas de courriel d’enregistrement.
Suite à votre choix d’affectation, un courriel contenant le lien internet vers le portail d’enregistrement à l’Ordre des médecins a été envoyé à l’adresse électronique que vous avez fournie au CNG pour la procédure des ECN.
Ce courriel est nominatif et ne doit pas être transféré.
Il est possible que vous n’ayez pas reçu ce courriel.
- Merci de vérifier en premier lieu qu’il n’ait pas été placé dans les spams ou le dossier des courriels indésirables de votre boîte mail.
- Si ce n’est pas le cas, pas d’inquiétude, cela n’a aucune conséquence sur votre affectation.
Jusqu'au 31 octobre, vous pouvez vous connecter sur votre compte CNG : le lien vers le portail d’enregistrement à l’Ordre des médecins est présent sur l’écran de notification d’affectation. Si ce lien n’apparaît pas ou ne fonctionne pas, nous vous invitons à faire une demande auprès du qui fera les actions nécessaires pour vous fournir un lien fonctionnel.
A partir du 1er novembre, l'enregistrement n'est possible qu'auprès du CDOM de votre choix, sur rendez-vous et muni d'une pièce d'identité :
Carte de Professionnel en Formation (CPF)
Je suis enregistré à l’Ordre, mais je n'ai pas reçu ma Carte de Professionnel de Santé en Formation (CPF) ou je n'ai pas reçu mes codes ...- ... et j'ai passé les ECN il y a plus d'un an
Merci de contacter le support de l'Agence du Numérique en Santé (ANS) par téléphone ou -
... et j'ai passé les ECN cette année
Vous recevrez votre Carte Professionnelle de Formation au cours du mois d'octobre, dans le cas contraire merci de contacter l'ANS
Compte en ligne
Je suis titulaire d’une licence de remplacement ou je me suis enregistré au conseil départemental, et je souhaite créer un compte sur le site web du Conseil national :Mot de passe oublié
J'ai oublié mon mot de passe ou mon mot de passe ne me permet pas d'accéder à mon compte en ligne.
Changement de coordonnées
Suite à mon enregistrement au RPPS, j’ai changé de données de contact (adresse de correspondance, adresse électronique ou numéro de téléphone).- Les modifications sur vos coordonnées de correspondance peuvent être effectuées via votre espace sécurisé :
- En cas de difficulté, il convient de contacter le CDOM de votre choix sur rendez-vous et muni d'une pièce d'identité :
État civil erroné
La convention passée entre l’Ordre des médecins et le CNG pour permettre l’enregistrement en ligne implique que cet enregistrement se fasse sur la base des données que vous avez fournies dans le cadre des Épreuves classantes nationalesUne fois votre enregistrement effectué, vous pourrez demander une rectification de vos données d’état-civil en contactant le CDOM de votre choix :
Changement de spécialité
Suite à un changement de spécialité lors du 3ème cycle, la spécialité affichée n'est plus celle à laquelle je me destine.- Les données affichées correspondent aux éléments publiés au Journal Officiel lors de votre affectation.
- Dès lors que votre enregistrement est effectif, ces informations sont modifiablesen contactant le CDOM de votre choix :
- En cas de renoncement à l’affectation suite aux ECN / procédure d’appariement : la décision du Directeur d’UFR, après réunion de la commission (Art. R. 632-2-10 du code de l’éducation) ;
- En cas d’un droit aux remords : la décision du directeur d’UFR vous autorisant à suivre une nouvelle spécialité et le document du coordonnateur local de la nouvelle spécialité précisant les semestres de l’ancien DES repris au titre de la nouvelle spécialité (Art. R. 632-11 du code de l’éducation) ;
- En cas de réorientation : la décision du directeur d’UFR sur proposition de la commission locale de coordination (Art. 59 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine).
Déclarer un diplôme supplémentaire
Je ne peux pas déclarer de diplôme supplémentaire.- La déclaration d'un nouveau diplôme pourra être possible lorsque vous effectuerez une des démarches suivantes auprès d'un CDOM : demande de votre première licence de remplacement, inscription à l'Ordre.









