Lanceur d'alerte
Temps de lecture : 6 mn

Le Cnom dispose désormais d’une procédure de recueil des signalements faits par les lanceurs d’alerte.
Il est au nombre des autorités externes instituées par la du 21 mars 2022 chargées recueillir de traiter les signalements émis par les lanceurs d’alerte (voir le ).
Situations visées par la loi
« Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance
Les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires (…) sont exclus du régime de l'alerte défini au présent chapitre ».
Les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires (…) sont exclus du régime de l'alerte défini au présent chapitre ».
Afin de faciliter la déclaration des signalements faits par les lanceurs d’alerte et de renforcer leur suivi, le CNOM met en place une procédure via une adresse spécifique
Cette adresse permet désormais à toute personne de signaler facilement toute violation grave d’une loi ou d’un règlement ou toute menace grave à l’intérêt général, dans le domaine de la santé ou de l’environnement dès qu'elle en a personnellement connaissance.
Missions du CNOM
Les missions du Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) sont définies par le code de la santé publique (articles L.4121-2 et L.4122-1) : veiller à la préservation des fondements de probité, de moralité, de dévouement et de compétences requises dans le cadre de l’exercice de la profession :- Le respect de l’éthique et de la déontologie médicale.
- Le maintien de la compétence et de la probité du corps médical.
- Veiller à la qualité des soins aux côtés des représentants des autres professionnels de santé et s’assurer de l’indépendance professionnelle de tous ses membres dans leurs relations avec l’industrie pharmaceutique et biomédicale.
- Evaluer le respect du principe de non-discrimination
- Assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale (notamment dans les situations d’exercice illégal de la médecine)
Garanties pour le lanceur d’alerte
- La garantie du strict respect de la confidentialité de votre identité
- Une irresponsabilité pénale prévue par l’article 122-9 du code pénal, si votre signalement porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause
- Les mesures de protection prévues par l’article L. 1132-3-3 du code du travail et par l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 (pour les agents de la fonction publique), comprenant notamment l’impossibilité pour votre employeur de vous sanctionner, licencier ou prendre une mesure discriminatoire à votre encontre pour avoir signalé une alerte dans le respect de la loi
La protection du lanceur d’alerte, prévue par les textes, est applicable en cas d’utilisation de bonne foi du dispositif, même si les faits s’avèrent par la suite inexacts ou ne donnent lieu à aucune suite.
A l’inverse, la dénonciation de faits inexacts en toute connaissance de cause peut exposer son auteur à d’éventuelles poursuites judiciaires, administratives ou disciplinaires.
A l’inverse, la dénonciation de faits inexacts en toute connaissance de cause peut exposer son auteur à d’éventuelles poursuites judiciaires, administratives ou disciplinaires.
Faire un signalement
Afin de faciliter l’analyse de votre signalement, notamment si des informations complémentaires sont nécessaires à son traitement, il est conseillé d’éviter les signalements anonymes. Dans le cadre de ses procédures et dans le respect des dispositions de la loi, le CNOM garantira le strict respect de la confidentialité des informations recueillies et de votre identité.
Un service dédié au recueil et à l’analyse des signalements est créé au CNOM.Plusieurs options vous sont offertes pour adresser votre signalement :
-
Par voie électronique à partir du lien suivant : «
» -
Par courrier, sous double enveloppe :
- Sur l’enveloppe intérieure doit figurer exclusivement la mention : « Signalement d’une alerte »
- Sur l’enveloppe extérieure uniquement l’adresse d’expédition : CNOM - 4 rue Léon Jost – 75017 Paris
- Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces instructions garantes de la confidentialité du traitement de votre dossier
- Ou par contact téléphonique : 01 53 89 33 30
Traitement du signalement
- Vous êtes informé par écrit de la réception de votre signalement dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de cette réception.
- Si le signalement ne relève pas de la procédure "lanceur d’alerte", vous en êtes informé, ainsi que, le cas échéant, de la possibilité qui vous est laissée de réorienter votre message (vers un autre service du CNOM ou vers une autre administration).
- Dans un délai de 3 mois (pouvant être étendu à 6 mois si l’affaire est complexe), vous êtes informé de la recevabilité de votre signalement, ainsi que des moyens et des délais des suites données à votre signalement. Vous serez avisé par écrit du résultat final des diligences mises en œuvre.
Plus d'informations
Pour toute question sur le statut des lanceurs d'alerte, vous pouvez contacter le Défenseur des droits, en charge de coordonner l’action des autorités externes en matière de signalement de lanceurs d’alerte :- par téléphone au 09 69 39 00 00 ;
- par ;
- par courrier gratuit sans affranchissement à : Défenseur des droits - Libre réponse 71120 - 75342 Paris CEDEX 07
Autres autorités de santé habilitées à recevoir votre signalement
Si votre signalement porte sur un autre type de manquement prévu par le et ne relève pas de la compétence du CNOM, le Conseil transmettra votre signalement au Défenseur des droits ou se mettra en relation avec l’organisme externe compétent visé dans le texte réglementaire au chapitre « santé » :- Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)
- Agence nationale de santé publique (Santé publique France)
- Haute Autorité de santé (HAS)
- Agence de la biomédecine
- Etablissement français du sang (EFS)
- Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN)
- Inspection générale des affaires sociales (IGAS)
- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
- Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute
- Conseil national de l'ordre des sage-femmes, pour l'exercice de la profession de sage-femme
- Conseil national de l'ordre des pharmaciens, pour l'exercice de la profession de pharmacien
- Conseil national de l'ordre des infirmiers, pour l'exercice de la profession d'infirmier
- Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste
- Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue
- Conseil national de l'ordre des vétérinaires, pour l'exercice de la profession de vétérinaire
Newsletter de février 2023
Temps de lecture : 5 mn

Au sommaire : l’Ordre manifeste pour la première fois aux côtés des médecins ; signature d’une convention de partenariat avec la CNIL ...
À la une
L’Ordre manifeste pour la première fois aux côtés des médecins
Le mardi 14 février dernier, le Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom) a pris part à la manifestation organisée pour protester contre la proposition de loi (PPL) Rist, actuellement discutée au Sénat.
Par cette action inédite, le Cnom veut faire état de sa vive préoccupation à l’égard des risques de désorganisation des soins que porte cette proposition de loi. L’adopter, c’est promettre aux Français une médecine à deux vitesses. L’adopter, c’est entériner des risques de perte de chance pour les patients.
Nous, médecins, ne pouvons accepter que certains de nos concitoyens n’aient pas accès à un diagnostic médical et à une stratégie thérapeutique qui relèvent de la compétence des médecins – et d’eux seuls – compte tenu de leur longue formation initiale et de leur formation continue.
Tout patient a le droit de voir un médecin s’il est malade. Seule la coordination par le médecin est à même de garantir aux patients l’accessibilité, la qualité et la sécurité de leur parcours de soins.
Les médecins ont fait des propositions s’appuyant sur des équipes de soins coordonnées par les médecins et associant l’ensemble des professionnels de santé en fonction de leurs compétences. Les médecins souhaitent ainsi apporter une réponse aux patients n’ayant pas accès à un médecin et à une prise en charge pluriprofessionnelle.
Par cette action inédite, le Cnom veut faire état de sa vive préoccupation à l’égard des risques de désorganisation des soins que porte cette proposition de loi. L’adopter, c’est promettre aux Français une médecine à deux vitesses. L’adopter, c’est entériner des risques de perte de chance pour les patients.
Nous, médecins, ne pouvons accepter que certains de nos concitoyens n’aient pas accès à un diagnostic médical et à une stratégie thérapeutique qui relèvent de la compétence des médecins – et d’eux seuls – compte tenu de leur longue formation initiale et de leur formation continue.
Tout patient a le droit de voir un médecin s’il est malade. Seule la coordination par le médecin est à même de garantir aux patients l’accessibilité, la qualité et la sécurité de leur parcours de soins.
Les médecins ont fait des propositions s’appuyant sur des équipes de soins coordonnées par les médecins et associant l’ensemble des professionnels de santé en fonction de leurs compétences. Les médecins souhaitent ainsi apporter une réponse aux patients n’ayant pas accès à un médecin et à une prise en charge pluriprofessionnelle.
Le chiffre
5 000 médecins libéraux ont défilé contre la loi Rist, mardi 14 février, du ministère de la Santé, à Paris, au Panthéon, selon les chiffres de la préfecture de police. Les organisateurs revendiquent, eux, 10 000 manifestants.
Les actus
Données de santé : partenariat entre le Cnom et la Cnil
Réaffirmer leur engagement commun pour la protection des données de santé et poursuivre la collaboration régulière entre les deux institutions : c’est l’objet de la signée entre le Cnom et la Cnil, le 3 février 2023. La Cnil conseillera le Cnom dans ses actions d’accompagnement des professionnels de santé, notamment dans la diffusion des bonnes pratiques en matière de protection des données de santé auprès des médecins en régions. De son côté, le Cnom partagera son expertise précieuse pour l’élaboration des référentiels du secteur santé, comme celui dédié à la gestion des cabinets médicaux publié en 2020. Cette convention de partenariat contribuera également à une plus grande sensibilisation à la protection des données de santé avec pour objectifs :
- la coproduction de fiches pratiques, d’affiches et de guides ;
- la mise à jour du guide Cnom-Cnil à destination des médecins ;
- l’organisation de présentations et d’événements communs, comme un rendez-vous annuel à destination des professionnels de santé et des patients.
Information préoccupante : un modèle pour vous guider
Complétée par le médecin, l'information préoccupante (IP) est un document transmis à la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes (CRIP) pour alerter sur un enfant ou un adolescent en danger ou à risque de danger. L’IP se justifie lorsque la situation d'un mineur peut laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l'être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou qui risquent de l'être. Cette possibilité de déroger au secret médical est prévue par la loi. Afin d’aider le médecin dans cette démarche, un a été élaboré en concertation entre le Cnom, la Société française de pédiatrie médico-légale, l’Observatoire national de la protection de l’enfance et les médecins référents protection de l’enfance.
Greffes et prélèvements : une légère hausse en 2022
+ 4% : c’est la hausse d’activité des greffes et prélèvements en 2022 par rapport à l’année précédente, rapportée par . Légère, cette hausse ne suffit toutefois pas à rattraper le niveau pré-pandémie : 5 494 greffes ont été réalisées en 2022, contre 5 901 en 2019. Des résultats néanmoins « encourageants », selon le Pr François Kerbaul, directeur du prélèvement et de la greffe d’organes et tissus de l’Agence, qui salue « l’engagement sans faille des équipes hospitalières ». Le prélèvement de tissus est également en hausse de 5,5 % en 2022, mais reste toujours moindre qu’en 2019. Pour expliquer cette baisse d’activité, l’Agence pointe la profonde crise structurelle que traverse actuellement l’hôpital. Améliorer la communication auprès des Français est également nécessaire, le taux d’opposition au don pour les personnes décédées et éligibles au don se situant autour des 30 %. Au 1er janvier 2023, 10 810 patients restaient dans l’attente d’un don.
En image
Notre reportage sur « Accueil Médecins Aveyron », le dispositif gagnant du département de l’Aveyron pour inciter les internes et jeunes médecins à choisir ce territoire.
À découvrir
Le dernier bulletin de l’Ordre est en ligne !
Au sommaire, notamment :
- un dossier sur la pénurie inédite de médicaments à laquelle sont confrontés médecins, pharmaciens et patients depuis plusieurs mois ;
- « Quelle prise en charge de la douleur en France ? » : les éléments de réponse de trois spécialistes ;
- un décryptage de la loi de financement de la sécurité sociale 2023 ;
- le portrait du Dr Florence Rigal, la nouvelle présidente de Médecins du monde.
L’Ordre des médecins sera présent à la manifestation du 14 février
Temps de lecture : 1 mn

Le 14 février prochain, le Cnom prendra part à la manifestation organisée pour protester contre la PPL Rist, actuellement discutée au Sénat.
Par cette action inédite, le Conseil national de l’Ordre veut faire état de sa vive préoccupation à l’égard des risques de désorganisation des soins que porte cette proposition de loi.
L’adopter, c’est promettre aux Français une médecine à deux vitesses. L’adopter, c’est entériner des risques de perte de chance pour les patients.
Nous, médecins, ne pouvons accepter que certains de nos concitoyens n’aient pas accès à un diagnostic médical et à une stratégie thérapeutique qui relèvent de la compétence des médecins – et d’eux seuls – compte tenu de leur longue formation initiale et de leur formation continue.
Tout patient a le droit de voir un médecin s’il est malade. Seule la coordination par le médecin est à même de garantir aux patients l’accessibilité, la qualité et la sécurité de leur parcours de soins.
Les médecins ont fait des propositions s’appuyant sur des équipes de soins coordonnées par les médecins et associant l’ensemble des professionnels de santé en fonction de leurs compétences. Les médecins souhaitent ainsi apporter une réponse aux patients n’ayant pas accès à un médecin et à une prise en charge pluriprofessionnelle.
L’adopter, c’est promettre aux Français une médecine à deux vitesses. L’adopter, c’est entériner des risques de perte de chance pour les patients.
Nous, médecins, ne pouvons accepter que certains de nos concitoyens n’aient pas accès à un diagnostic médical et à une stratégie thérapeutique qui relèvent de la compétence des médecins – et d’eux seuls – compte tenu de leur longue formation initiale et de leur formation continue.
Tout patient a le droit de voir un médecin s’il est malade. Seule la coordination par le médecin est à même de garantir aux patients l’accessibilité, la qualité et la sécurité de leur parcours de soins.
Les médecins ont fait des propositions s’appuyant sur des équipes de soins coordonnées par les médecins et associant l’ensemble des professionnels de santé en fonction de leurs compétences. Les médecins souhaitent ainsi apporter une réponse aux patients n’ayant pas accès à un médecin et à une prise en charge pluriprofessionnelle.
Temps de lecture : 1 mn
Modèle d'information préoccupante - Enfants et adolescents en danger ou risque de danger - Document destiné aux médecins
L'information préoccupante est une information transmise à la CRIP pour alerter sur la situation d'un mineur, bénéficiant ou non d'un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l'être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être.
La finalité de cette transmission est d'évaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier.
Afin d’aider le médecin dans cette démarche, un modèle d’information préoccupante a été élaboré en concertation entre le Conseil national de l’Ordre des médecins, la Société Française de Pédiatrie Medico-Légale, l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance et les médecins référents protection de l’enfance (MRPE).
Médecins n°83
Temps de lecture : 1 mn

Découvrez le bulletin de l'Ordre des médecins de janvier-février 2023
Vous trouverez notamment au sommaire :
- Elections complémentaires au Conseil interrégional de la Réunion-Mayotte
- Elections complémentaires aux Chambres disciplinaires de première instance du Grand Est, d’Ile-de-France et de la Réunion-Mayotte
Voir la vidéo associée au reportage de la page 8 - « La stratégie payante de l’Aveyron pour attirer les jeunes médecins »
Convention de partenariat Cnom-Cnil
Temps de lecture : 1 mn

Le 3 février le Cnom et la Cnil ont signé une convention de partenariat réaffirmant leur engagement commun pour la protection des données de santé.
La signature de cette convention de partenariat par la présidente de la CNIL, Marie-Laure Denis, et le président du CNOM, le Docteur François Arnault, concrétise une collaboration régulière et nécessaire.
Leurs échanges sont en effet essentiels pour la protection des données de santé, données sensibles, dans un contexte où, d’une part, les professionnels de santé collectent de plus en plus de données personnelles et, d’autre part, le nombre d’établissements de santé victimes de cyberattaques croit sensiblement.
La CNIL conseillera le CNOM dans ses actions d’accompagnement des professionnels de santé, notamment dans la diffusion des bonnes pratiques en matière de protection des données de santé auprès des médecins en régions.
Le CNOM partagera son expertise précieuse pour l’élaboration des référentiels du secteur santé, comme celui dédié à la gestion des cabinets médicaux publié en 2020.
Cette convention de partenariat contribuera également à une plus grande sensibilisation à la protection des données de santé avec pour objectifs :
- la coproduction de fiches pratiques, d’affiches et de guides ;
- la mise à jour du guide CNOM-CNIL à destination des médecins ;
- l’organisation de présentations et d’évènements communs, comme un rendez-vous annuel à destination des professionnels de santé et des patients.
Webzine #18 : l'éthique médicale
Temps de lecture : 1 mn

A lire le nouveau webzine de l'Ordre des médecins : "l'éthique médicale face aux évolutions de la société"
Notamment au
- l’intervention de Jean-Claude Ameisen, qui revient sur le rôle du Comité consultatif national d’éthique,
- une interview croisée sur l’origine de la clause de conscience spécifique et les conditions de son application (Pr Aubert Agostini, Cngof, et Dr Anne-Marie Trarieux, Cnom),
- la lutte contre les violences (Dr Marie-Pierre Glaviano-Ceccaldi, Cnom),
- un reportage au sein d’une unité cognitivo-comportementale, créée dans le cadre du plan Alzheimer
- les interviews du Dr Isabelle Héron (Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale), du Dr François-Xavier Moronval (Alias Doc FX, urgentiste), d'Alain Claeys (CCNE) et de David Gruson (directeur du programme santé Luminess).
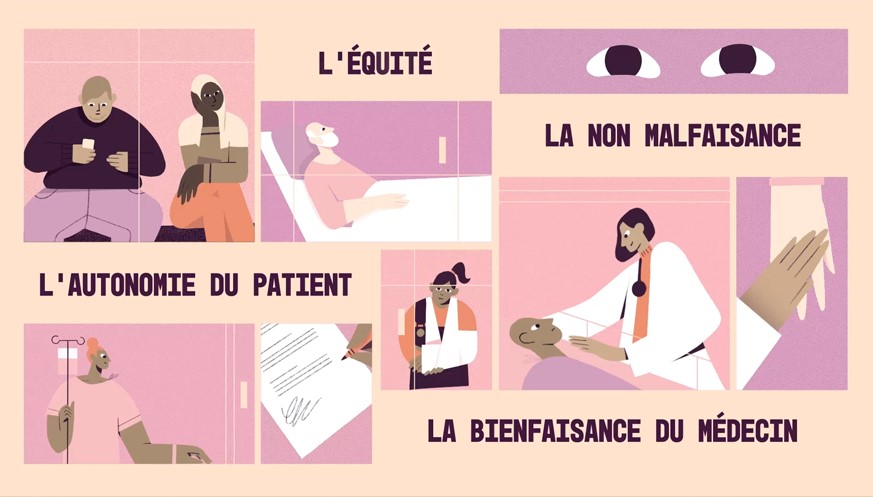
Le webzine est une publication thématique semestrielle qui approfondit une problématique en croisant les regards de nombreux intervenants - .
Newsletter de janvier 2023
Temps de lecture : 6 mn

Au sommaire : les vœux du président du Cnom, les rendez-vous médicaux non honorés, la messagerie de l'espace médecin, le nouveau webzine...
À la une
Le Dr Arnault présente les vœux du Cnom
Le Dr François Arnault, président du Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom), a présenté le jeudi 12 janvier les vœux de l’Institution aux médecins et aux acteurs de la santé, en présence d’Agnès Firmin Le Bodo, la ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des professions de santé.
Le président a dressé un premier bilan des principaux chantiers menés depuis le début du mandat du nouveau bureau, en juin 2022 :
- Faire des propositions pour l’accès aux soins. « Tout patient a le droit de voir un médecin s’il est malade, a réaffirmé le président. L’organisation doit être territoriale, personnalisée et cordonnée par le médecin et son équipe autour de son patient. Le médecin traitant doit être la porte d’entrée dans le soin, et le verrou contre un système de santé à deux vitesses. »
- Mener une réflexion sur la fin de vie. « Les trois niveaux de l’Institution – départemental, régional et national – sont associés à cette réflexion. Notre rôle n’est pas d’intervenir dans le débat sociétal, notre objectif est d’accompagner le médecin et de le protéger dans son exercice, en préservant notamment la clause de conscience spécifique », a détaillé le président.
Le Dr Arnault a réaffirmé l’opposition de l’Institution aux projets parlementaires sur la régulation des jeunes médecins. Il a également adressé son soutien total aux médecins victimes de violences et d’agressions. Enfin, le président a rappelé la mobilisation pleine et entière de l’Ordre, pour parachever sa transformation et sa modernisation.
Le chiffre
Source : Institut national du Cancer
Les actus
Rendez-vous non honorés : communiqué commun
Le Cnom et l’Académie nationale de médecine publient un communiqué de presse commun pour manifester leur vive préoccupation face aux graves conséquences soulevées par les rendez-vous médicaux non honorés. Plusieurs enquêtes suggèrent que chaque semaine, 6 à 10 % des patients ne se présentent pas à leur rendez-vous. Cela correspond à une perte de temps de consultation de près de deux heures hebdomadaires pour le médecin quelle qu’en soit la discipline et, par extrapolation, près de 27 millions de rendez-vous non honorés par an. Le Cnom et l’Académie nationale de médecine demandent aux pouvoirs publics :- De sensibiliser et responsabiliser le public par des campagnes d’information dénonçant cette manifestation d’incivilité hautement préjudiciable à l’offre de soins ;
- D’amender les propositions de loi sur l’accès aux soins en cours de discussion, afin que le code de la santé publique permette de responsabiliser les patients sur les rendez-vous non honorés.
Lire également
Médecin victime d’une agression : signalez-la
Les agressions de médecins durant leur exercice ont augmenté depuis la pandémie de Covid-19. Créé en 2002 par le Cnom, est l’interlocuteur des pouvoirs publics dans la lutte contre les actes de violences commis contre les médecins. Il recense chaque année ces actes à partir des déclarations adressées par les médecins à leur conseil départemental de l’Ordre. Si vous êtes ou avez été victime d’une agression, vous pouvez remplir et adresser une à votre conseil départemental de l’Ordre. Ainsi, vous pourrez recevoir, si vous le souhaitez, le soutien de l'institution ordinale. Vous permettrez également au Cnom de connaître plus précisément la nature des événements au niveau local, d'analyser les problèmes rencontrés par les praticiens et d'étudier les réponses possibles.Repérer l’inhalation de protoxyde d’azote
L’usage de protoxyde d’azote est en forte augmentation ces dernières années chez les jeunes adultes. Qu’il soit inhalé via des cartouches ou des bonbonnes destinées à un usage culinaire, les effets recherchés sont les mêmes : l’hilarité, l’euphorie, la désinhibition. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) publie, à destination des professionnels de santé, une pour aider au diagnostic et à la prise en charge d’une intoxication au protoxyde d’azote. Pour toute question sur les risques liés à l’inhalation de cette substance, vous pouvez contacter le centre d’addictovigilance de votre région.Une étude auprès des remplaçants et jeunes installés
Le syndicat ReAGJIR lance un état des lieux sur les remplaçants et les jeunes installés, afin de mieux connaître l’activité de ces deux populations en 2022. Les concernés sont invités à répondre à deux questionnaires distincts. Pour les remplaçants, il s’agit de: jeunes remplaçants en médecine générale en cabinet médical, maison de santé, centre de santé et/ou centre hospitalier, vous pouvez y participer jusqu’au 28 février 2023. Le second questionnaire, , s’adresse aux jeunes installés ou praticiens de moins de 5 ans en médecine générale en cabinet médical, maison de santé, centre de santé et/ou centre hospitalier. Si vous souhaitez y répondre, vous aurez besoin du détail de votre patientèle médecin traitant disponible sur votre espace amelipro. La limite pour y participer est également fixée au 28 février 2023.En image
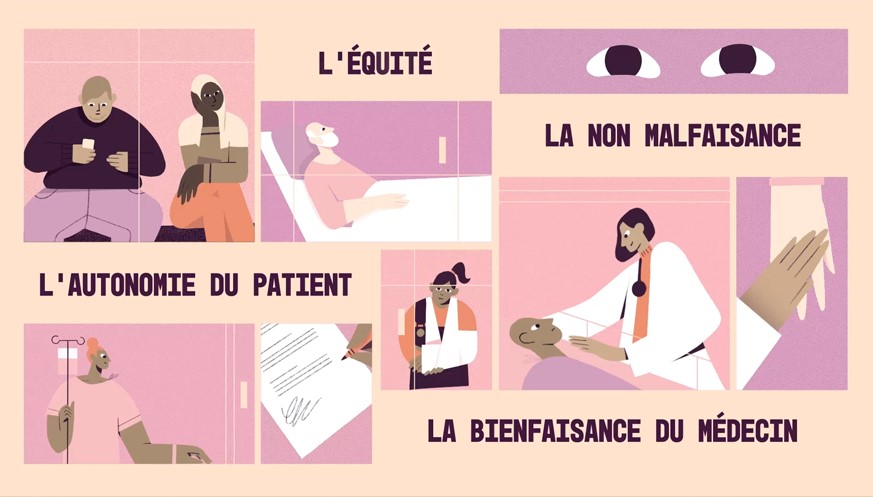
Découvrez le tout nouveau webzine de l’Ordre, sur le sujet de l’éthique médicale. Au sommaire, notamment : l’intervention de Jean- Claude Ameisen, qui revient sur le rôle du Comité consultatif national d’éthique, une interview croisée sur l’origine de la clause de conscience spécifique et les conditions de son application, et un reportage au sein d’une unité cognitivo-comportementale, créée dans le cadre du plan Alzheimer.
À découvrir
La messagerie de l’Espace médecin
Développée par le Cnom, la messagerie de l’Espace médecin est un nouveau canal de communication rapide, facile et sécurisé qui permet aux médecins, docteurs junior et internes de dialoguer avec leur Conseil départemental de l’Ordre et d’obtenir rapidement les informations dont ils ont besoin. Elle est en cours de déploiement dans tous les départements.
L'éthique médicale face aux évolutions de la société
Temps de lecture : 0 mn
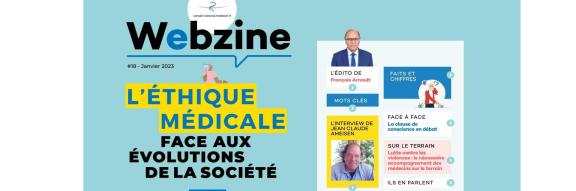
Ce webzine propose, tout en abordant de grands débats de société, une réflexion de fond sur l'éthique médicale.
Rendez-vous médicaux non honorés
Temps de lecture : 2 mn

Communiqué commun de l'Académie nationale de médecine et du Conseil national de l'Ordre des médecins.
L’Académie nationale de médecine et le Conseil national de l’Ordre des médecins souhaitent manifester leur vive préoccupation face aux graves conséquences soulevées par les rendez-vous médicaux non honorés.
Plusieurs enquêtes suggèrent que chaque semaine 6 à 10 % des patients ne se présentent pas à leur rendez-vous, ce qui correspond à une perte de temps de consultation de près de deux heures hebdomadaires pour le médecin quelle qu’en soit la discipline et, par extrapolation, près de 27 millions de rendez-vous non honorés par an. Par ailleurs, près de deux tiers de ces défections concerneraient un premier rendez-vous. Ces chiffres sont le reflet d’une évolution regrettable.
Ce phénomène qui semble en constante augmentation entraine de sérieuses répercussions sur l’offre de soins : il désorganise gravement le travail quotidien des médecins libéraux et des consultations hospitalières, réduit la disponibilité médicale des praticiens impactés, limite l’accès aux soins pour des patients en ayant réellement besoin et contribue à majorer le nombre de patients qui s’adressent aux services d’urgence.
Si l’oubli d‘un rendez-vous pris longtemps à l’avance ou une impossibilité de dernière minute peuvent être exceptionnellement invoqués, l’analyse de ces défections souligne la fréquence des rendez-vous pris en double chez plusieurs praticiens en fonction de la convenance du patient et témoigne d’une déconsidération pour l’acte médical considéré comme un bien de consommation.
Face à ce véritable problème de santé publique, l’Académie nationale de médecine et le Conseil national de l’Ordre des médecins demandent aux pouvoirs publics :
- de sensibiliser et responsabiliser le public par des campagnes d’information dénonçant cette manifestation d’incivilité hautement préjudiciable à l’offre de soins,
- d’amender les propositions de loi sur l’accès aux soins en cours de discussion, afin que le code de la santé publique permette de responsabiliser les patients sur les rendez-vous non honorés.





